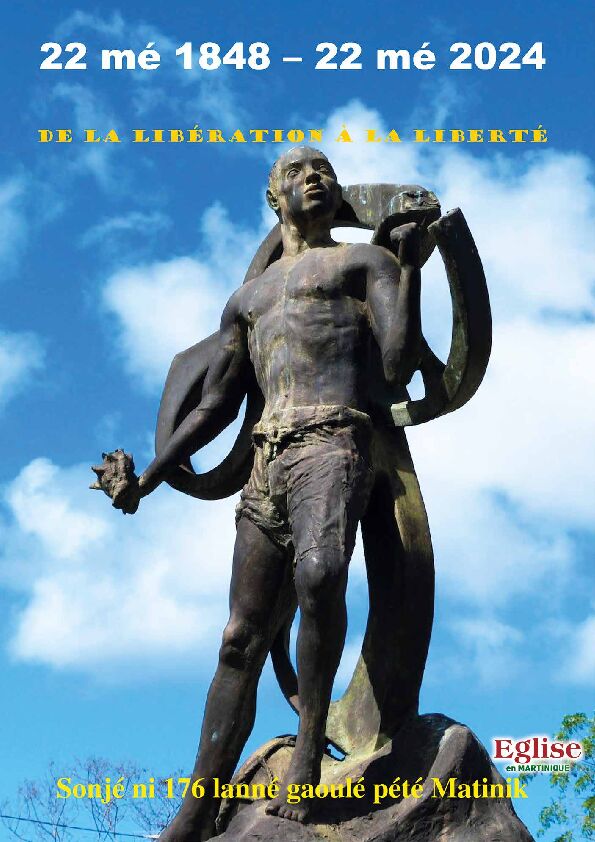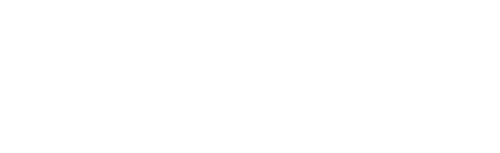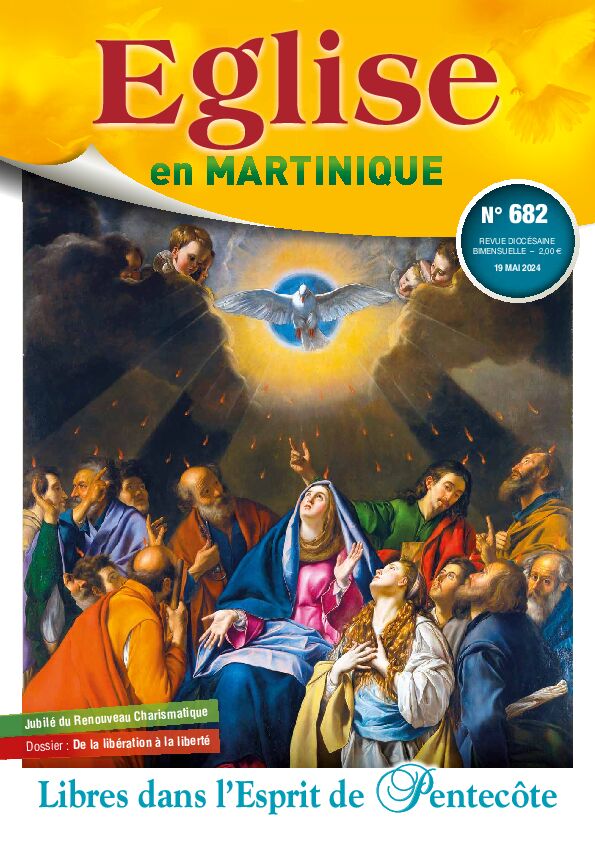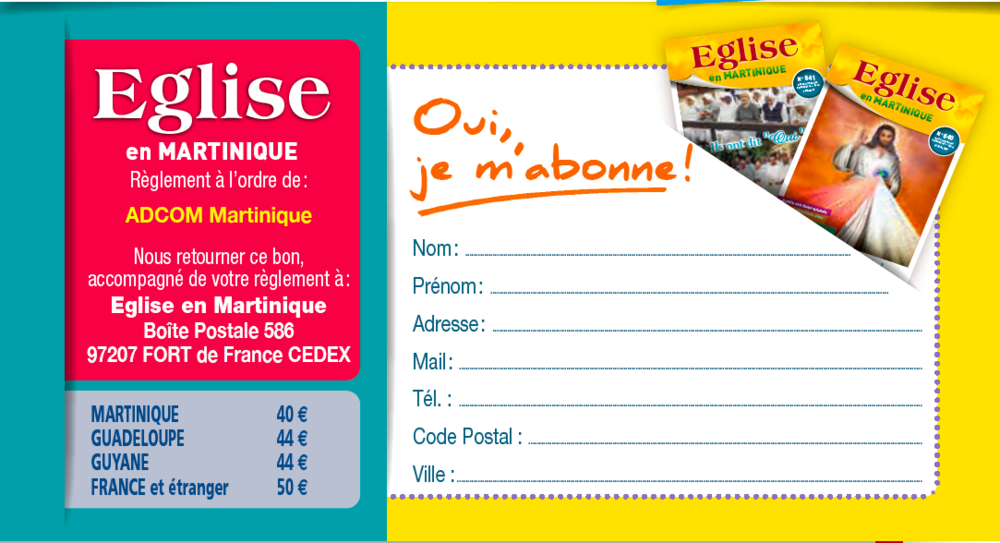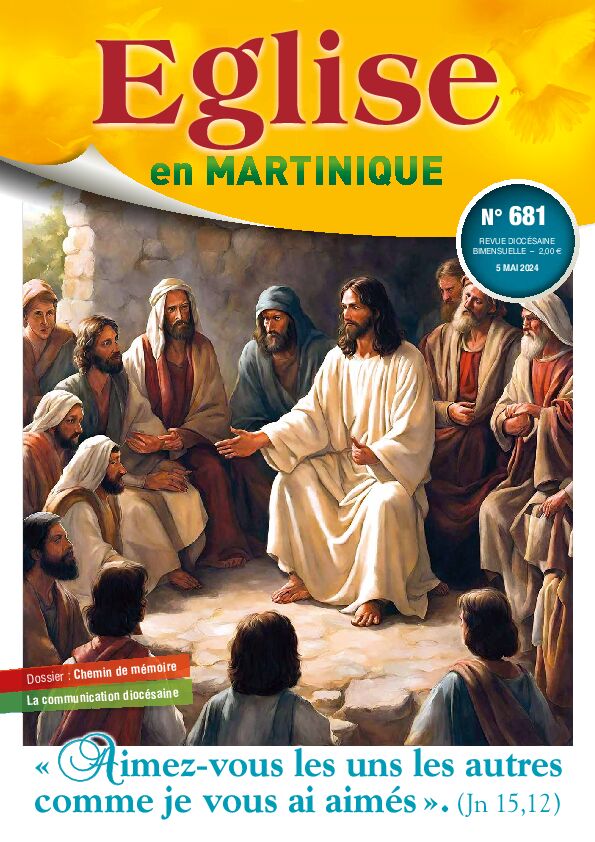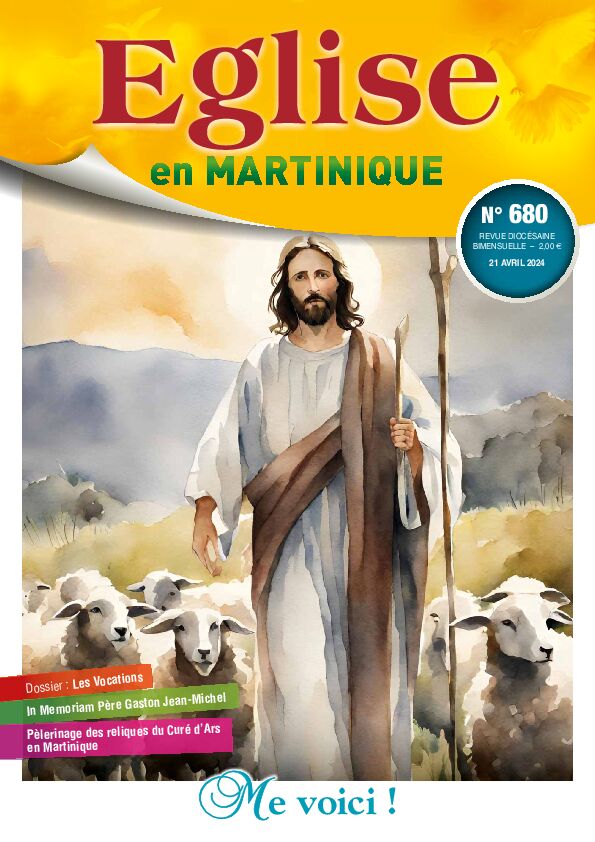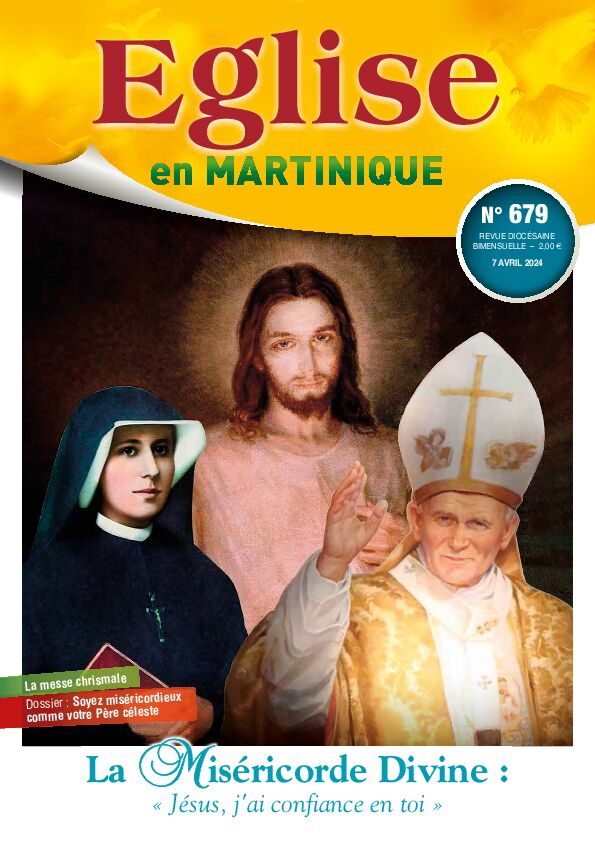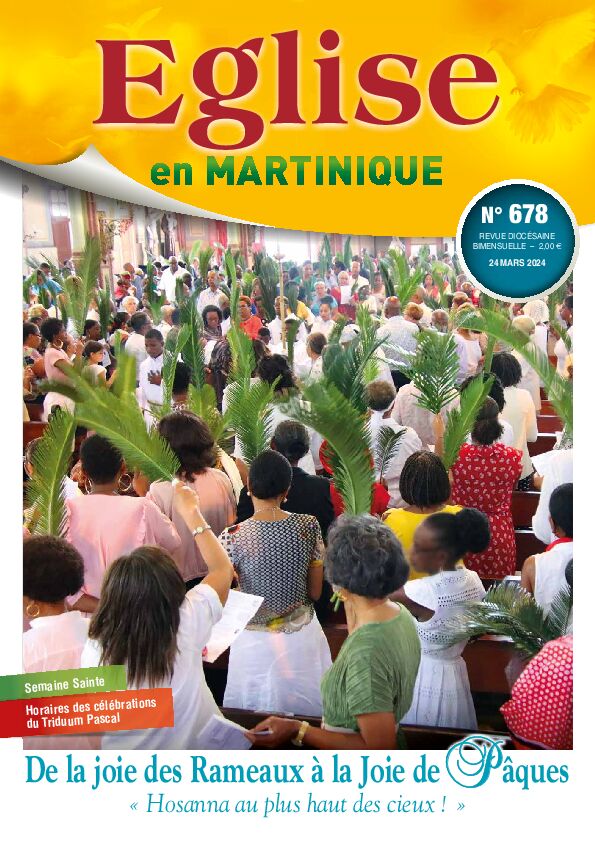Avec la solennité de la Pentecôte, nous célébrons le début de l’Eglise et le commencement de la mission des disciples pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Comme les disciples, autrefois réunis dans la crainte et l’incertitude autour de Marie au cénacle, nous aussi, avec notre passé et notre histoire, avons reçu de notre Seigneur Jésus la promesse de l’Esprit Saint.
SOMMAIRE
- EDITORIAL
- MOT DE L'ÉVÊQUE - "N’ayez pas peur que votre prochain devienne saint"
Le contrat de confiance
- ÉGLISE UNIVERSELLE - Message de sa Sainteté le Pape François Pour la 1ère journée mondiale des enfants
- LITURGIE
- VIE DUD DIOCESE
-
- Présentation de la paroisse du François
- Des pistes éducatives pour l’éducation des enfants
- Témoignage d’une maman
- Jubilé du Renouveau charismatique catholique de la Martinique;
- « La femme poto-mitan, héritière de la négresse marronne ?;
- La chapelle de Pontaléry, lieu de mémoire Sonjé, prédjé é adoré - Commémoration de l’abolition de l’esclavage à la paroisse de Rivière-Salée
- PAGES JEUNES
- DOSSIER "De la libération à la Liberté"
- ANTJÈ LÉGLIZ-LA - "Femmes dans l'Eglise "
S'ABONNER
Pour vous abonner à la revue diocésaine "Eglise en Martinique" et le recevoir directement chez vous en avant-première :
Je m'abonne !
Abonnement en ligne sécurisé avec un compte sur l'extranet du diocèse
ou
Par courrier avec ce bulletin :
Téléchargez ici, remplissez et renvoyez le bulletin d'abonnement par courrier à l'adresse indiquée
TARIFS
- 2€ le numéro
- 40€ / annuel pour la Martinique ( 24 numéros)
- 44€ / annuel pour la Guadeloupe et la Guyane ( 24 numéros)
- 50€ / annuel pour la Métropole et l'étranger ( 24 numéros)
CONTACT
Pour toute demande liée à la revue diocésaine "Eglise en Martinique" / Gestion des abonnements, vous pouvez contacter le secrétariat :
Eve-Lyne BAZIN : egliseenmartinique@gmail.com - 0596 72 55 04
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-Michel MONCONTHOUR (DEI)
RÉDACTEUR EN CHEF : P. Crépin HOUNZA
Tirages : 8000 ex - I.S.S.N 0759-4895 Commission paritaire N°1115L87225
Mise en page - Impression : Caraïb Ediprint
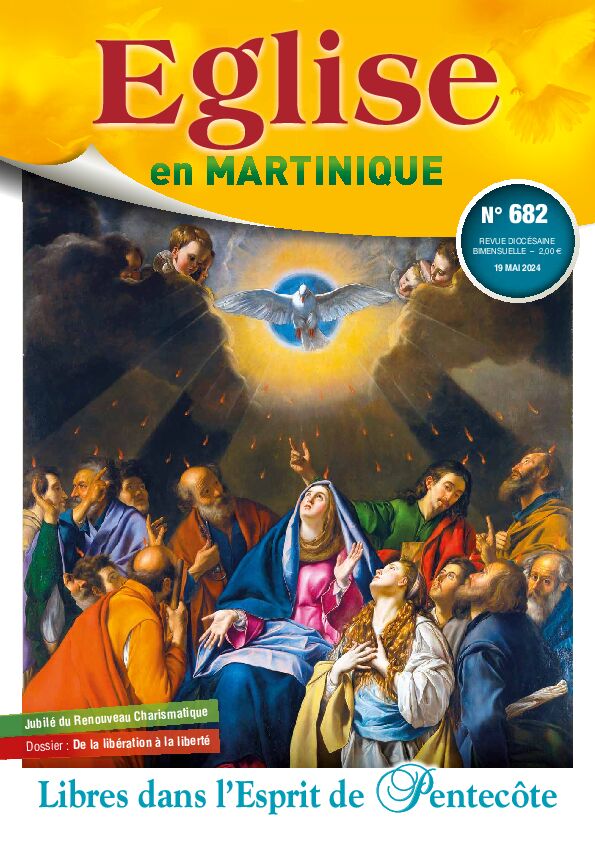
Page 1
Eglise
en MARTINIQUE
Libres dans l’Esprit de PPentecôte
N° 682
REVUE DIOCÉSAINE
BIMENSUELLE – 2,00 €
19 MAI 2024
Hommage au père Filopon
Dossier : De la libération à la liberté
Jubilé du Renouveau Charismatique

Page 2
2
3
Sommaire
A
vec la solennité de la Pentecôte, nous célébrons le
début de l’Eglise et le commencement de la mission des
disciples pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Comme
les disciples, autrefois réunis dans la crainte et l’incertitude
autour de Marie au cénacle, nous aussi, avec notre passé et
notre histoire, avons reçu de notre Seigneur Jésus la promesse
de l’Esprit Saint. Nous sommes appelés à la liberté et à un
avenir renouvelé par le Saint-Esprit. Le récit de la Pentecôte
nous montre comment l’Esprit Saint a la capacité de vaincre
la peur, de libérer l’humain de l’esclavage et de remplir les
cœurs d’une confiance inébranlable. L’Esprit Saint n’offre pas
une échappatoire temporaire aux épreuves. Il instaure une
transformation durable et définitive. Les disciples, remplis du
Saint Esprit, étaient transformés à tel point que leurs proches
avaient du mal à les reconnaître. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous des Galiléens ? ». Ce sont en effet des hommes et des
femmes en qui l’Esprit Saint est à l’œuvre : Ils parlent, chacun
les comprenait dans sa propre langue ; ils annoncent la Bonne
Nouvelle sans peur, ils guérissent les malades… Laissons-nous
habiter et conduire par l’Esprit de Dieu.
Inspiré par ce même Esprit Saint, le Pape François propose
l’organisation de la première Journée mondiale des enfants, les
24 et 25 mai 2024, autour du thème : « Voici que je fais toute chose
nouvelle ». Par ces mots, le pape nous invite à saisir la nouveauté
suscitée par l’Esprit en nous et autour de nous. Cette journée
voulue par le pape coïncide avec la fête des mères. De diverses
manières, les enfants renouvelleront leur gratitude et leur amour
à leur mère qui, en réponse, peuvent reprendre cette belle phrase
à leur égard : « tu es précieux aux yeux de Dieu » et à mes yeux.
Dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage
le 22 mai, les membres de l’Observatoire socio-Politique de
l’Eglise en Martinique (l’OSPEM) jettent, dans ce numéro de
notre revue diocésaine, un regard d’espérance sur la Martinique
d’aujourd’hui à travers une réflexion approfondie sur la
thématique De la libération à la liberté : La liberté souhaitée par
tous doit être l’œuvre de tous et être construite par tous dans la
confiance réciproque.
La rubrique ‘La vie du Diocèse’ de cette parution articule
actualité, histoire, mémoire, foi et culture avec des sujets comme
l’éducation des enfants, le témoignage d’une maman, la femme
poto-mitan, les lieux et les temps de mémoires, le jubilé de la
grande aventure spirituelle du Renouveau charismatique en
Martinique.
Nous croyons que l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde.
Qu’il descende sur la Martinique et la renouvelle ! Que les fêtes,
les manifestations et les temps forts organisés en ces temps-ci se
vivent dans la mouvance de l’Esprit Saint.
Bonne fête de la Pentecôte
Bonnes fêtes à tous et à toutes
Père Crépin Hounza ■
« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté »
2 Cor. 3,17
EDITORIAL
MOT DE L’EVÊQUE
LITURGIE
VIE DU DIOCÈSE
• La Parole Dominicale
• Un regard d’espérance
sur la Martinique d’aujourdhui
• Femmes dans l’Église
• Présentation de la paroisse du François
• Des pistes éducatives
pour l’éducation des enfants
• Témoignage d’une maman
• Jubilé du Renouveau charismatique
catholique de la Martinique
• La femme poto-mitan, héritière de la
négresse marronne ?
• La chapelle de Pontaléry, lieu de mémoire
• Sonjé, prédjé é adoré - Commémoration
de l’abolition de l’esclavage à la paroisse
de Rivière-Salée
• N’ayez pas peur que votre prochain
devienne saint
• Message du Saint-Père pour la première
Journée Mondiale des Enfants
3
• Message du Saint-Père pour la première • Message du Saint-Père pour la première
EGLISE UNIVERSELLE
6
7
8
9
10
12
13
AN TJÈ LÉGLIZ-LA 18
Dossier : DE LA LIBÉRATION
À LA LIBERTÉ
4
5
EDITORIAL 2
AGENDA DE L'EVEQUE 19
14
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean-Michel MONCONTHOUR
RÉDACTEUR EN CHEF : père Crépin HOUNZA
MISE EN PAGE – IMPRESSION
Caraïb Ediprint – Bois Quarré – 97232 Lamentin – Tél. 05 96 50 28 28
TIRAGE : 8 000 EXEMPLAIRES
I.S.S.N. 0759-4895 –
Commission paritaire N° 1115L87225
ADMINISTRATION – RÉDACTION
Archevêché de la Martinique – Rue du R.P. Pinchon
97200 Fort de France - Tél. 05 96 63 70 70
SERVICE DES ABONNEMENTS
Archevêché de la Martinique – BP 586
97207 Fort de France Cedex – Tél. 05 96 63 70 70 – 05 96 72 55 04
http://martinique.catholique.fr – egliseenmartinique@gmail.com

Page 3
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 3
D
ieu a choisi un moyen bien
précis pour annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres
et aux captifs, pour relever notre
pays, pourtant baptisé dans la foi
catholique, mais qui passe à côté de
son destin par manque d'amour et
de réconciliation ! Depuis 2000 ans,
Jésus donne part au salut en suscitant
un Peuple de prêtres, peuple de rois,
une assemblée de saints ! C’est nous,
l’Église. Nous avons reçu en héritage
l’intégralité des moyens du salut.
Ce peuple se fonde sur un contrat
de confiance entre ses membres : je
confie mon chemin de sainteté à mes
frères et je me sens responsable de
leur salut éternel.
Là, se joue la foi dans l’Église : Qu’est-ce
que je souhaite pour mon prochain ?
Quelles sont, selon moi, ses intentions
quand il me parle, m'encourage,
me fait une correction, me rend un
service, me fait un cadeau, exerce son
ministère ou son autorité ?… Dans mes
interactions communautaires, est-ce
que je me sens en sécurité fraternelle
avec les fidèles, les responsables, les
prêtres, les évêques ? Ou est-ce que
je me tiens à distance, ne devant rien
à quiconque et n’attendant rien de
personne… chak bèt-a-fé ka kléré pou
nam-li !?
Dieu Notre Père ne peut se contenter
de ce que ses enfants l'aiment, Il
veut aussi qu'ils s’aiment entre eux
et travaillent au salut les uns des
autres. Il attend de chaque fidèle
qu’il soit un mendiant d’amour : non
pas une personne imbue et parfaite
(ce qui engendre mépris, médisances
et déceptions) mais un pauvre qui
veut suivre Jésus, vivre dans l'Esprit
et faire confiance à ses frères pour
l’aider à devenir saint !
Être saint, ce n'est pas suivre une
petite morale qui n'embête personne,
mais avoir le désir permanent de
suivre Dieu dans l’Église malgré
ses faiblesses. C’est pourquoi,
s’évitant de fréquenter ceux qui nous
tirent vers le bas, il vaut mieux vivre
avec des pécheurs qui nous aident à
devenir saints qu'avec de « bonnes
personnes » qui nous flattent,
nous croient déjà parfaits, passent
leur chemin ou se dispensent de
s’intéresser à notre salut.
Pouvons-nous en vérité garantir aux
nouveaux convertis, aux couples en
situation irrégulière (on dit plutôt
« en cheminement »), à nos jeunes
plus ou moins cathos, aux pratiquants
occasionnels, aux visiteurs d’un
instant, mais aussi aux grenouilles de
bénitier les plus assidues, à chaque
prêtre, à chaque séminariste… que
s'ils répondent à l’appel de donner
leur vie à la suite du Christ dans notre
communauté, ils seront accueillis
avec bienveillance et accompagnés
avec amour dans un chemin de
sainteté. Par la grâce, savons-nous
nous aimer dans une confiance
réciproque malgré les limites de
notre humanité pécheresse !?
OUI ! Dieu merci, malgré les
inévitables désillusions, nos prêtres,
à la messe chrismale, renouvellent
le don d’eux-mêmes pour ce peuple
que Dieu leur a confié. Chaque
année, ils se confient à l’évêque
et aux fidèles pour être conduits
à la sainteté, et non pas portés au
pinacle, calomniés ou induits en
tentation ! Ils redonnent leur vie à
cette communauté qui se confie à
leur ministère pour devenir le peuple
saint que Dieu s’est acquis au prix de
son sang.
OUI ! Dieu merci, le peuple, à son
tour, fait confiance au clergé. Tant
de fidèles mettent leur vie entre
les mains de leurs pasteurs et
leurconfient la mise en œuvre du
projet de Dieu et l’ambition divine
de la sainteté.
Notre contrat confiance entre évêques,
prêtres et baptisés est donc réel et
incontournable. Il honore la Sainte
Trinité et fait de nous un royaume
de prêtres. Cette alliance mutuelle,
même si l’ennemi la déteste, cherche
à l’éroder, à l’ébranler par le péché et
tant d’évènements douloureux, est
garantie par le sacrifice du Fils et le
don de l’Esprit.
N’ayons donc pas peur que notre
prochain devienne saint !
Ainsi commence la Communion des
saints !
+ Fr David Macaire, Archevêque
de Saint-Pierre et Fort-de-France
■
N’ayez pas peur que votre prochain
devienne saint
Le contrat de confiance
MOT DE L’ÉVÊQUE

Page 4
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 6824
EGLISE UNIVERSELLE
C
hers enfants,
Votre première Journée
Mondiale approche : elle aura
lieu à Rome les 25 et 26 mai. C‛est
pourquoi j‛ai pensé à vous envoyer un
message. […].
Je l‛adresse avant tout à chacun de
vous personnellement, à toi, cher
enfant, parce que “tu es précieux”
aux yeux de Dieu (Is 43, 4), comme la
Bible nous l‛enseigne et comme Jésus
l‛a démontré tant de fois.
En même temps, j‛adresse ce message
à tous, parce que vous êtes tous
importants et parce qu‛ensemble,
proches et lointains, vous manifestez
le désir de chacun d‛entre nous de
grandir et de se renouveler. Vous nous
rappelez que nous sommes tous des
enfants et des frères, et que personne
ne peut exister sans quelqu‛un qui l‛ait
mis au monde, ni grandir sans avoir
d‛autres personnes à qui donner de
l‛amour et de qui recevoir de l‛amour
Ainsi, vous tous, les enfants, qui êtes la
joie de vos parents et de vos familles,
vous êtes aussi la joie de l‛humanité et
de l‛Église dans lesquelles chacun est
comme un maillon d‛une très longue
chaîne qui s‛étend du passé à l‛avenir
et qui couvre toute la terre. C‛est
pourquoi je vous recommande de
toujours écouter attentivement les
histoires des grands : de vos mamans,
de vos papas, de vos grands-parents
et de vos arrière-grands-parents ! […].
Mes petits amis, pour nous renouveler
et renouveler le monde, il ne suffit
pas que nous soyons ensemble entre
nous : Il est nécessaire de rester
unis à Jésus. De lui, nous recevons
beaucoup de courage : il est toujours
proche, son Esprit nous précède et
nous accompagne sur les chemins
du monde. Jésus nous dit : « Voici
que je fais toutes choses nouvelles »
(Ap 21, 5) ; ce sont les paroles que
j'ai choisies comme thème de votre
première Journée mondiale. Ces mots
nous invitent à devenir aussi agiles que
des enfants pour saisir la nouveauté
suscitée par l'Esprit en nous et
autour de nous. Avec Jésus, nous
pouvons rêver d‛une humanité nouvelle
et nous engager dans une société
plus fraternelle et attentive à notre
maison commune, en commençant par
des choses simples, comme saluer
les autres, demander la permission,
s‛excuser, dire merci. Le monde se
transforme d‛abord par de petites
choses, sans avoir honte de ne faire
que de petits pas. Au contraire,
notre petitesse nous rappelle que
nous sommes fragiles et que nous
avons besoin les uns des autres,
comme les membres d‛un seul corps
(cf. Rm 12,5 ; 1 Co 12, 26).[…]
Au contraire, si l‛on est ensemble,
tout est différent ! Pensez à vos
amis : comme il est beau d‛être avec
eux, à la maison, à l‛école, en paroisse,
à l‛aumônerie, partout ; de jouer, de
chanter, de découvrir de nouvelles
choses, de s‛amuser, tous ensemble,
sans laisser personne de côté. L‛amitié
est très belle et ne grandit que de
cette façon, dans le partage et le
pardon, avec patience, courage,
créativité et imagination, sans peur
et sans préjugés.
Et maintenant, je veux
vous confier un secret
important : pour être vraiment
heureux, il faut prier, beaucoup prier,
tous les jours, parce que la prière
nous relie directement à Dieu, elle
remplit notre cœur de lumière et de
chaleur et nous aide à tout faire avec
confiance et sérénité. Jésus aussi
priait toujours le Père. Et savez-vous
comment il l‛appelait ? Dans sa langue,
il l‛appelait simplement Abba, ce qui
signifie Papa (cf. Mc 14, 36). Faisons-le
nous aussi ! Nous le sentirons toujours
proche. Jésus lui-même nous l‛a promis
lorsqu‛il a dit : « Là où deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d‛eux » (Mt 18, 20). […]
Chers amis, Dieu, qui nous aime depuis
toujours (cf. Jr 1, 5), a pour nous le
regard du papa le plus aimant et de
la maman la plus tendre. Il ne nous
oublie jamais (cf. Is 49,15) et nous
accompagne chaque jour et nous
renouvelle par son Esprit.
Avec la Très Sainte Vierge Marie et
saint Joseph, prions avec ces mots :
Viens, Esprit Saint,
montre-nous ta beauté
reflétée dans les visages
des enfants de la terre.
Viens Jésus,
qui fais toutes choses nouvelles,
qui es le chemin qui nous conduit
au Père,
viens et reste avec nous.
Amen.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 2 mars 2024
François■
Message du Saint-Père
25-26 mai 2024
Message du Saint-Père
25-26 mai 2024
pour lapremièreJournée
Mondiale
desEnfant s
Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux
■■
confiance et sérénité. Jésus aussi
priait toujours le Père. Et savez-vous
comment il l‛appelait ? Dans sa langue,
il l‛appelait simplement Abba, ce qui
signifie Papa (cf. Mc 14, 36). Faisons-le
nous aussi ! Nous le sentirons toujours nous aussi ! Nous le sentirons toujours
proche. Jésus lui-même nous l‛a promis
lorsqu‛il a dit : « Là où deux ou trois
CC
lieu à Rome les 25 et 26 mai. C‛est
pourquoi je vous recommande de
toujours écouter attentivement les toujours écouter attentivement les
histoires des grands : de vos mamans, histoires des grands : de vos mamans, histoires des grands : de vos mamans, histoires des grands : de vos mamans,
de vos papas, de vos grands-parents de vos papas, de vos grands-parents
et de vos arrière-grands-parents ! […].et de vos arrière-grands-parents ! […].
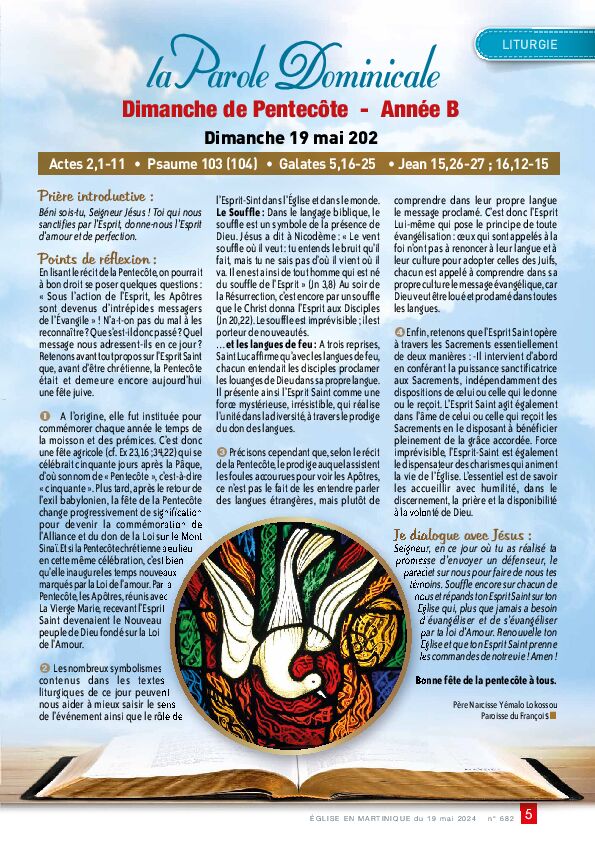
Page 5
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 55
Dimanche 19 mai 202
laP Parole DDominicale
Dimanche de Pentecôte - Année B
Prière introductive :
Béni sois-tu, Sei gneur Jésus ! Toi qui nous
sanctifies par l’Esprit, donne-nous l’Esprit
d’amour et de perfection.
Points de réflexion :
En lisant le récit de la Pentecôte, on pourrait
à bon droit se poser quelques questions :
« Sous l’action de l’Esprit, les Apôtres
sont devenus d’intrépides messagers
de l’Évangile » ! N’a-t-on pas du mal à les
reconnaître ? Que s’est-il donc passé ? Quel
message nous adressent-ils en ce jour ?
Retenons avant tout propos sur l’Esprit Saint
que, avant d’être chrétienne, la Pentecôte
était et demeure encore aujourd’hui
une fête juive.
➊ A l’origine, elle fut instituée pour
commémorer chaque année le temps de
la moisson et des prémices. C’est donc
une fête agricole (cf. Ex 23,16 ;34,22) qui se
célébrait cinquante jours après la Pâque,
d’où son nom de « Pentecôte », c’est-à-dire
« cinquante ». Plus tard, après le retour de
l’exil babylonien, la fête de la Pentecôte
change progressivement de signification
pour devenir la commémoration de
l’Alliance et du don de la Loi sur le Mont
Sinaï. Et si la Pentecôte chrétienne a eu lieu
en cette même célébration, c’est bien
qu’elle inaugure les temps nouveaux
marqués par la Loi de l’amour. Par la
Pentecôte, les Apôtres, réunis avec
La Vierge Marie, recevant l’Esprit
Saint devenaient le Nouveau
peuple de Dieu fondé sur la Loi
de l’Amour.
➋ Les nombreux symbolismes
contenus dans les textes
liturgiques de ce jour peuvent
nous aider à mieux saisir le sens
de l’événement ainsi que le rôle de
l’Esprit-Sint dans l’Église et dans le monde.
Le Souffle : Dans le langage biblique, le
souffle est un symbole de la présence de
Dieu. Jésus a dit à Nicodème : « Le vent
souffle où il veut : tu entends le bruit qu’il
fait, mais tu ne sais pas d’où il vient où il
va. Il en est ainsi de tout homme qui est né
du souffle de l’Esprit » (Jn 3,8) Au soir de
la Résurrection, c’est encore par un souffle
que le Christ donna l’Esprit aux Disciples
(Jn 20,22). Le souffle est imprévisible ; il est
porteur de nouveautés.
…et les langues de feu : A trois reprises,
Saint Luc affirme qu’avec les langues de feu,
chacun entendait les disciples proclamer
les louanges de Dieu dans sa propre langue.
Il présente ainsi l’Esprit Saint comme une
force mystérieuse, irrésistible, qui réalise
l’unité dans la diversité, à travers le prodige
du don des langues.
➌ Précisons cependant que, selon le récit
de la Pentecôte, le prodige auquel assistent
les foules accourues pour voir les Apôtres,
ce n’est pas le fait de les entendre parler
des langues étrangères, mais plutôt de
comprendre dans leur propre langue
le message proclamé. C’est donc l’Esprit
Lui-même qui pose le principe de toute
évangélisation : ceux qui sont appelés à la
foi n’ont pas à renoncer à leur langue et à
leur culture pour adopter celles des Juifs,
chacun est appelé à comprendre dans sa
propre culture le message évangélique, car
Dieu veut être loué et proclamé dans toutes
les langues.
➍ Enfin, retenons que l’Esprit Saint opère
à travers les Sacrements essentiellement
de deux manières : -Il intervient d’abord
en conférant la puissance sanctificatrice
aux Sacrements, indépendamment des
dispositions de celui ou celle qui le donne
ou le reçoit. L’Esprit Saint agit également
dans l’âme de celui ou celle qui reçoit les
Sacrements en le disposant à bénéficier
pleinement de la grâce accordée. Force
imprévisible, l’Esprit-Saint est également
le dispensateur des charismes qui animent
la vie de l’Église. L’essentiel est de savoir
les accueillir avec humilité, dans le
discernement, la prière et la disponibilité
à la volonté de Dieu.
Je dialogue avec Jésus :
Seigneur, en ce jour où tu as réalisé ta
promesse d’envoyer un défenseur, le
paraclet sur nous pour faire de nous tes
témoins. Souffle encore sur chacun de
nous et répands ton Esprit Saint sur ton
Eglise qui, plus que jamais a besoin
d’évangéliser et de s’évangéliser
par ta loi d’Amour. Renouvelle ton
Eglise et que ton Esprit Saint prenne
les commandes de notre vie ! Amen !
Bonne fête de la pentecôte à tous.
Père Narcisse Yémalo Lokossou
Paroisse du Françoi
s ■
Actes 2,1-11 • Psaume 103 (104) • Galates 5,16-25 • Jean 15,26-27 ; 16,12-15
LITURGIE
change progressivement de signification
pour devenir la commémoration de
l’Alliance et du don de la Loi sur le Mont
Sinaï. Et si la Pentecôte chrétienne a eu lieu
en cette même célébration, c’est bien
qu’elle inaugure les temps nouveaux
marqués par la Loi de l’amour. Par la
Pentecôte, les Apôtres, réunis avec
La Vierge Marie, recevant l’Esprit
Saint devenaient le Nouveau
Les nombreux symbolismes
contenus dans les textes
liturgiques de ce jour peuvent liturgiques de ce jour peuvent
nous aider à mieux saisir le sens
de l’événement ainsi que le rôle de
à la volonté de Dieu.
Je dialogue avec Jésus :
Seigneur, en ce jour où tu as réalisé ta
Je dialogue avec Jésus :
Seigneur, en ce jour où tu as réalisé ta
Je dialogue avec Jésus :
promesse d’envoyer un défenseur, le
paraclet sur nous pour faire de nous tes
témoins. Souffle encore sur chacun de
nous et répands ton Esprit Saint sur ton
Eglise qui, plus que jamais a besoin
d’évangéliser et de s’évangéliser
par ta loi d’Amour. Renouvelle ton
Eglise et que ton Esprit Saint prenne
les commandes de notre vie ! Amen !
Bonne fête de la pentecôte à tous.
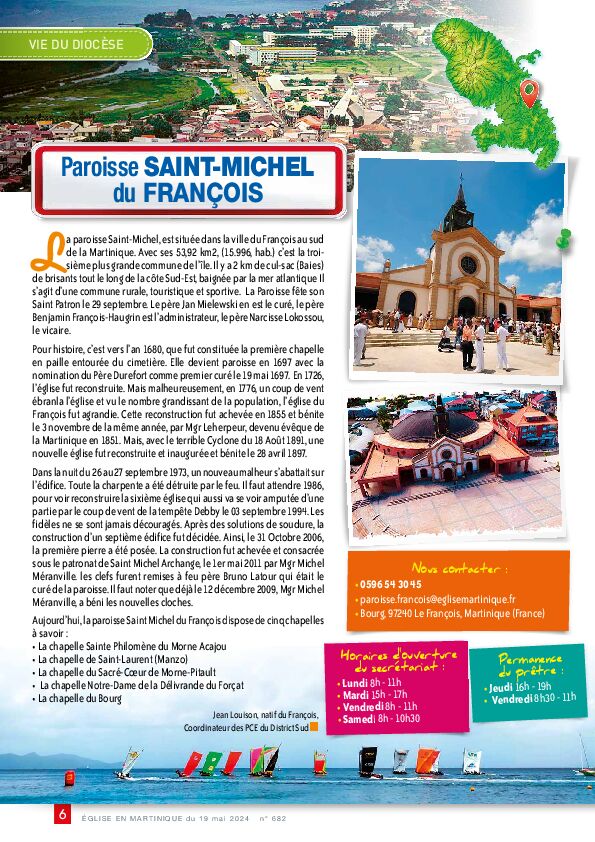
Page 6
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 6826
Paroisse SAINT-MICHEL
du FRANÇ OIS
L
a paroisse Saint-Michel, est située dans la ville du François au sud
de la Martinique. Avec ses 53,92 km2, (15.996, hab.) c’est la troi-
sième plus grande commune de l’île. Il y a 2 km de cul-sac (Baies)
de brisants tout le long de la côte Sud-Est, baignée par la mer atlantique Il
s’agit d’une commune rurale, touristique et sportive. La Paroisse fête son
Saint Patron le 29 septembre. Le père Jan Mielewski en est le curé, le père
Benjamin François-Haugrin est l’administrateur, le père Narcisse Lokossou,
le vicaire.
Pour histoire, c’est vers l’an 1680, que fut constituée la première chapelle
en paille entourée du cimetière. Elle devient paroisse en 1697 avec la
nomination du Père Durefort comme premier curé le 19 mai 1697. En 1726,
l’église fut reconstruite. Mais malheureusement, en 1776, un coup de vent
ébranla l’église et vu le nombre grandissant de la population, l’église du
François fut agrandie. Cette reconstruction fut achevée en 1855 et bénite
le 3 novembre de la même année, par Mgr Leherpeur, devenu évêque de
la Martinique en 1851. Mais, avec le terrible Cyclone du 18 Août 1891, une
nouvelle église fut reconstruite et inaugurée et bénite le 28 avril 1897.
Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1973, un nouveau malheur s’abattait sur
l’édifice. Toute la charpente a été détruite par le feu. Il faut attendre 1986,
pour voir reconstruire la sixième église qui aussi va se voir amputée d’une
partie par le coup de vent de la tempête Debby le 03 septembre 1994. Les
fidèles ne se sont jamais découragés. Après des solutions de soudure, la
construction d’un septième édifice fut décidée. Ainsi, le 31 Octobre 2006,
la première pierre a été posée. La construction fut achevée et consacrée
sous le patronat de Saint Michel Archange, le 1er mai 2011 par Mgr Michel
Méranville. les clefs furent remises à feu père Bruno Latour qui était le
curé de la paroisse. Il faut noter que déjà le 12 décembre 2009, Mgr Michel
Méranville, a béni les nouvelles cloches.
Aujourd’hui, la paroisse Saint Michel du François dispose de cinq chapelles
à savoir :
• La chapelle Sainte Philomène du Morne Acajou
• La chapelle de Saint-Laurent (Manzo)
• La chapelle du Sacré-Cœur de Morne-Pitault
• La chapelle Notre-Dame de la Délivrande du Forçat
• La chapelle du Bourg
Jean Louison, natif du François,
Coordinateur des PCE du District Sud
■
Horaires d'ouverture
du secrétariat :
• Lundi 8h - 11h
• Mardi 15h - 17h
• Vendredi 8h - 11h
• Samedi 8h - 10h30
Permanence
du prêtre :
• Jeudi 16h - 19h
• Vendredi 8h30 - 11h
Nous contacter :
• 0596 54 30 45
• paroisse.francois@eglisemartinique.fr
• Bourg, 97240 Le François, Martinique (France)
VIE DU DIOCÈSE
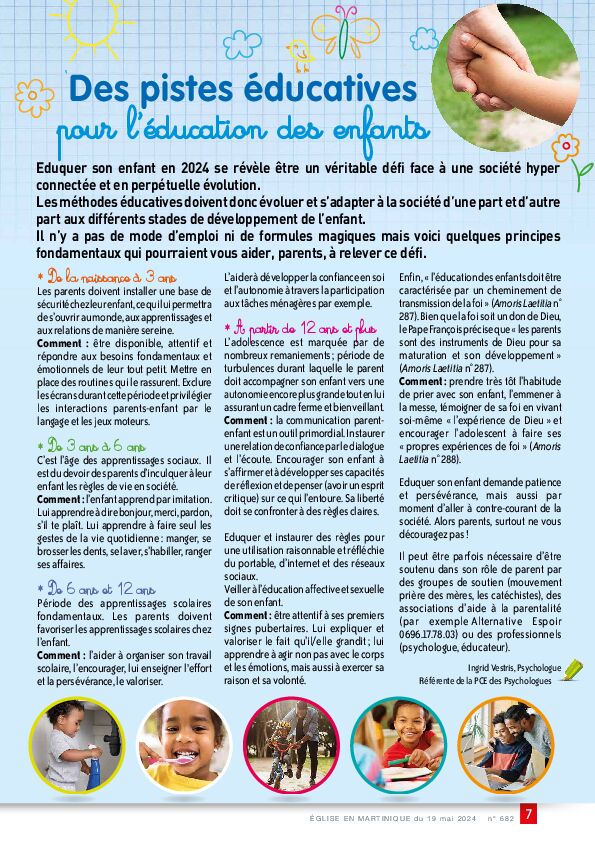
Page 7
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 7
Eduquer son enfant en 2024 se révèle être un véritable défi face à une société hyper
connectée et en perpétuelle évolution.
Les méthodes éducatives doivent donc évoluer et s’adapter à la société d’une part et d’autre
part aux différents stades de développement de l’enfant.
Il n’y a pas de mode d’emploi ni de formules magiques mais voici quelques principes
fondamentaux qui pourraient vous aider, parents, à relever ce défi.
* De la naissance à 3 ans
Les parents doivent installer une base de
sécurité chez leur enfant, ce qui lui permettra
de s’ouvrir au monde, aux apprentissages et
aux relations de manière sereine.
Comment : être disponible, attentif et
répondre aux besoins fondamentaux et
émotionnels de leur tout petit. Mettre en
place des routines qui le rassurent. Exclure
les écrans durant cette période et privilégier
les interactions parents-enfant par le
langage et les jeux moteurs.
*
De 3 ans à 6 ans
C’est l’âge des apprentissages sociaux. Il
est du devoir des parents d’inculquer à leur
enfant les règles de vie en société.
Comment : l’enfant apprend par imitation.
Lui apprendre à dire bonjour, merci, pardon,
s’il te plaît. Lui apprendre à faire seul les
gestes de la vie quotidienne : manger, se
brosser les dents, se laver, s’habiller, ranger
ses affaires.
* De 6 ans et 12 ans
Période des apprentissages scolaires
fondamentaux. Les parents doivent
favoriser les apprentissages scolaires chez
l’enfant.
Comment : l’aider à organiser son travail
scolaire, l’encourager, lui enseigner l'effort
et la persévérance, le valoriser.
L’aider à développer la confiance en soi
et l’autonomie à travers la participation
aux tâches ménagères par exemple.
* A partir de 12 ans et plus
L’adolescence est marquée par de
nombreux remaniements ; période de
turbulences durant laquelle le parent
doit accompagner son enfant vers une
autonomie encore plus grande tout en lui
assurant un cadre ferme et bienveillant.
Comment : la communication parent-
enfant est un outil primordial. Instaurer
une relation de confiance par le dialogue
et l’écoute. Encourager son enfant à
s’affirmer et à développer ses capacités
de réflexion et de penser (avoir un esprit
critique) sur ce qui l’entoure. Sa liberté
doit se confronter à des règles claires.
Eduquer et instaurer des règles pour
une utilisation raisonnable et réfléchie
du portable, d’internet et des réseaux
sociaux.
Veiller à l’éducation affective et sexuelle
de son enfant.
Comment : être attentif à ses premiers
signes pubertaires. Lui expliquer et
valoriser le fait qu’il/elle grandit ; lui
apprendre à agir non pas avec le corps
et les émotions, mais aussi à exercer sa
raison et sa volonté.
Enfin, « l’éducation des enfants doit être
caractérisée par un cheminement de
transmission de la foi » (Amoris Laetitia n°
287). Bien que la foi soit un don de Dieu,
le Pape François précise que « les parents
sont des instruments de Dieu pour sa
maturation et son développement »
(Amoris Laetitia n° 287).
Comment : prendre très tôt l’habitude
de prier avec son enfant, l’emmener à
la messe, témoigner de sa foi en vivant
soi-même « l’expérience de Dieu » et
encourager l’adolescent à faire ses
« propres expériences de foi » (Amoris
Laetitia n° 288).
Eduquer son enfant demande patience
et persévérance, mais aussi par
moment d’aller à contre-courant de la
société. Alors parents, surtout ne vous
découragez pas !
Il peut être parfois nécessaire d’être
soutenu dans son rôle de parent par
des groupes de soutien (mouvement
prière des mères, les catéchistes), des
associations d’aide à la parentalité
(par exemple Alternative Espoir
0696.17.78.03) ou des professionnels
(psychologue, éducateur).
Ingrid Vestris, Psychologue
Référente de la PCE des Psychologues
Des pistes éducatives
pour l’éducation des enfants

Page 8
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 6828
N
ous traversons une période délicate
et il est crucial de faire preuve d'une
vigilance constante pour assurer
l'éducation de nos enfants.
J’ai été élevée avec ma grand-mère en
partie et j’ai beaucoup de respect et une
attention particulière pour les personnes
âgées.
Dans la famille que nous avons créée
avec Frantz, mon époux, chaque enfant
avait un rôle précis à jouer. C’est une
règle tacite profondément ancrée dans
mes habitudes de vie et je l’ai inculqué
à mes enfants.
Dès leur plus jeune âge, j’ai enseigné à
mes enfants à assumer des responsabili-
tés à hauteur de leurs capacités, comme
ranger leurs jouets et leur chambre,
mettre le linge sale dans le panier dédié
à ça, s’habiller seul, se laver seul ou
dresser la table. En effet, manger autour
d’une table est une habitude ancrée dans
notre quotidien, car c’est le moment où
les membres de la famille se partagent les
anecdotes de la journée, leurs problèmes
ou leur joie.
En grandissant, ils ont progressivement
eu de nouvelles responsabilités, notam-
ment faire la vaisselle, les courses, par-
ticiper à la préparation des repas, et
quand mon aîné a commencé à travailler,
je lui ai appris à participer aux activités
financières de la famille tant qu’il vivait
sous notre toit.
En tant que parent catholique, je ne me
considère pas supérieur ou inférieur aux
autres parents chrétiens, et j'ai essayé
d'inculquer à mes enfants les valeurs de la
foi, notamment le pardon et la confiance.
Ma vision de l'éducation est soutenue et
enrichie par le principe chrétien de la
dignité humaine et par ma foi en Dieu.
J'ai consacré toute ma vie à l'éducation
de mes 5 enfants (2 garçons et 3 filles).
Je suis reconnaissante de ce privilège et
j'en suis également fière, avec mes erreurs
et mes réussites, qui ne manquent pas.
Mon époux et moi aimions lire et nous
avons inculqué le goût de la lecture à
nos enfants. Leur scolarité n’a pas été
un problème et je suis plutôt fière de leur
parcours scolaire, car ils avaient soif
d’apprendre.
Le principal sujet de conflit entre mon
mari et moi a été les jeux vidéo. Lui
trouvait normal que nos deux garçons
y jouent souvent. Moi, je considérais
qu’il était important de leur fixer des
limites, lui, il ne trouvait pas ça si "grave"
parce que tous les garçons de leur âge y
jouaient. Ils avaient à l’époque 16 et 14
ans. Je finissais par prendre des sanctions
comme confisquer les manettes des jeux
vidéo. Avec l’aîné de 16 ans, c’était de
plus en plus difficile. Comme tous les
adolescents, il résistait, se rebellait et
finissait même par me parler mal.
L’adolescence est une période difficile,
car les enfants s’engouffrent très vite
dans les failles du couple et cherchent à
monter un parent contre l’autre. Il faut
être solides et solidaires.
Mon mari et moi avons fini par en dis-
cuter ensemble et nous avons établi une
règle absolue, c’est de ne jamais afficher
un désaccord en leur présence.
Je réprouve les punitions corporelles. J'en
ai reçu dans mon enfance et je trouvais
ça vexant, cependant, malgré toute ma
bonne volonté, il m'est arrivé de perdre
mon calme et de donner une petite tape
sur le mollet ou le dos de la main de mes
enfants, quand ils étaient petits et qu'ils ne
respectaient pas les règles. En écrivant,
je constate qu'il y a un paradoxe dans
mon approche éducative, car on ne peut
pas inculquer aux enfants des moyens
pacifiques de régler les conflits tout en
les réprimandant physiquement. Mais
bon… C’était une façon de montrer mon
exaspération après avoir répété plusieurs
fois les mêmes interdits. Aujourd’hui, la
question ne se pose plus, car ils n'ont plus
l’âge des punitions et l'efficacité de cette
méthode n'a pas été très probante. Je ne
crois pas les avoir traumatisés. De toute
façon, je n’aspire pas à être une maman
parfaite mais une maman aimante.
Aujourd’hui, j’ai 55 ans, mon aîné à 28
ans et il s’est marié, il y a bientôt 2 ans.
Dans un mois, je serai grand-mère pour
la première fois et cela me comble de
joie. C’est une autre étape de ma vie que
j’attendais avec impatience.
Mes trois premiers enfants travaillent,
les deux derniers sont étudiants ; l’une
au Canada et la dernière au campus de
Schoelcher. Ils sont tous adultes.
Bien que les enfants aient grandi et
aient entamé leur propre parcours, nous,
parents, ne cesseront jamais de remplir
notre fonction de père et de mère. Même si
notre aide se limite à prier pour eux, bien
que cela puisse sembler peu, en réalité,
c'est déjà beaucoup.
Éloïse V,
(une maman de la paroisse de Coridon)
Témoignage
d’une maman
VIE DU DIOCÈSE

Page 9
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 9
Dimanche 19 et lundi 20 mai, des centaines de chrétiens sont attendus sur le stade de Rivière-
Pilote pour célébrer le jubilé du Renouveau charismatique catholique de la Martinique.
Q
u’est-ce que le Renouveau
charismatique ? C’est un courant
de réveil spirituel qui traverse
l’Église et s’applique à manifester le
mystère de la Pentecôte. C’est une
expérience de la grâce de Dieu qui conduit
le chrétien à puiser dans la richesse du
christianisme. C’est la résurgence du
christianisme des origines qui était celui
des apôtres (cf. Raniero Cantalamessa).
Dans son allocution en 1975, le Pape Paul
VI avait déclaré que : « Le Renouveau
est une chance pour l’Église et pour le
monde ». C’est la réponse à la prière
du Pape Jean XXIII pour une nouvelle
Pentecôte faite au début du Concile
Vatican II. Jean Paul II parlera d’une grâce
venue à point pour sanctifier l’Église.
Le Renouveau charismatique c’est
la prise de conscience de la réalité de
l’Esprit Saint et de son action qui nous
fait découvrir personnellement que nous
sommes habités par cet Esprit qui a fait
naître l’Église et la fait renaître encore
aujourd’hui.
Le Renouveau charismatique né
aux États Unis en 1967 va très vite se
répandre et arriver en Martinique en
1974. Rapidement, les premiers groupes
de prière se sont formés au Couvent de
Cluny, au Monastère de Terreville et au
Marin à l’initiative de certains prêtres,
religieuses et laïcs.
Certains groupes sont devenus depuis
des communautés.
La colonne vertébrale du Renouveau
charismatique est l’effusion de l’Esprit
qui n’est ni un sacrement ni un nouveau
baptême mais une appropriation de la
grâce reçue au baptême.
L’effusion de l’Esprit donne un goût
nouveau pour la louange, la parole de Dieu,
les sacrements, l’écoute, l’intercession, la
vie fraternelle et le témoignage et ce sont
toutes ces activités qui vont ponctuer la
vie des groupes de prière.
Le Renouveau charismatique à travers
les groupes de prière attire les gens
de tous les milieux. Toutes les classes
sociales se côtoient en toute familiarité
particulièrement ceux qui avaient perdu
tout contact avec l’Église ou qui n’en faisait
pas partie.
Qu’elles soient en difficulté sociale
ou autre, toutes les personnes sont
accueillies comme des personnes à part
entière, non jugées mais valorisées.
Le Renouveau s’est toujours battu pour se
faire reconnaître une légitimité au sein de
l’Église. L’archevêque Mgr David Macaire
a toujours accueilli favorablement les
communautés et encouragé fortement
les groupes de prière.
L’un des fruits du Renouveau pour l’Église
est l’engagement de la grande majorité de
ses membres : auxiliaires de l’eucharistie,
catéchèse, visite des malades…
Le Renouveau charismatique est
structuré. La coordination du renouveau
charismatique qui travaille en étroite
collaboration avec l’aumônier père Nicaise
Ossébi est un service de communion au
service des groupes de prière : organiser
des rencontres, retraites, formation…
Profitons donc de ces deux jours de grâce
et de bénédiction pour célébrer le jubilé
du Renouveau charismatique et soyons
tous ensemble, unis, pour rendre grâce à
Dieu pour le chemin parcouru avec l’Esprit
Saint, pour son œuvre dans nos vies, pour
toutes les grâces reçues, les guérisons
obtenues, pour toutes les vocations
sacerdotales, religieuses et laïques, la
croissance spirituelle … et pour tous les
projets qu’il confiera à ses enfants.
Raymonde Moundangui
Coordinatrice diocésaine
du Renouveau charismatique
■
Jubilé du
Renouveau charismatique catholique
de la Martinique

Page 10
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68210
La femme poto-mitan,
héritière de la négresse marronne ?héritière de la négresse marronne ?
D
ans l’espace public martiniquais,
nombreuses sont les repré-
sentations esthétiques érigeant
de manière concrète ou abstraite
la figure rebelle et verticale du Nèg
Mawon, épitomé de la libération des
esclavisé.e.s et de la pratique historique
du marronnage. Rappelons que dans la
Caraïbe, le terme « marrons » désigne les
Africains esclavisés fugitifs qui se sont
libérés de l’oppression des plantations,
se cachant dans les montagnes ou dans
les lieux les plus reculés et se constituant
en communautés marronnes dans
des zones quasi-inaccessibles pour les
autorités esclavagistes. Historiquement,
les marrons ont mené de multiples
attaques contre les plantations dans le but
de libérer leurs compatriotes, d’obtenir
des ressources et d’assurer ainsi la survie
de leur communauté. Le marronnage
désigne donc les luttes fondamentales
et intrinsèques contre l’esclavage ainsi
que toutes les formes de résistance à
l’oppression, les actes de rébellion, de
sabotage et de désobéissance civile au
nom de la justice, la liberté et la dignité
humaine. L’histoire du marronnage
semble néanmoins très masculino-
centrée, à l’exception de quelques figures
emblématiques de la résistance féminine
pendant l’esclavage et pendant la période
post-abolition: la Reine Nanny, redoutable
cheffe des Marrons jamaïcains au 18ème
siècle ; l’emblématique Mulâtresse
Solitude, figure centrale de la rébellion
des esclavisé.e.s en Guadeloupe, devenue
héroïne littéraire grâce au roman d’André
Schwarz-Bart; Lumina Sophie Ruptus dite
« Surprise », fille d’esclaves affranchis
et figure marquante des rébellions
anticoloniales post-abolition, notamment
l’Insurrection de 1870 en Martinique.
Il faut dire que d’une manière générale, les
sociétés caribéennes ont mis en exergue
les figures du marronnage par le prisme de
la masculinité et les imaginaires collectifs
tendent encore à idéaliser le nègre
marron héroïque et meneur des grandes
révoltes libératrices par opposition au
nègre relativement docile et résigné au
travail forcé dans la plantation. Dans cette
même logique de construction binaire,
nos imaginaires tendent à minimiser le
rôle du « nègre de maison » au profit
du « nègre des champs » et dans le
cas des femmes esclavisées, quoi que
nombreuses à cultiver les champs, celles
qui occupaient les sphères domestiques
ont longtemps été décrites comme des
victimes passives disposant d’une moindre
capacité à la rébellion et au marronnage. Il
paraît important de préciser que dans les
plantations des Amériques, les femmes
ont été exploitées aussi cruellement que
les hommes: elles étaient forcées à planter,
faucher, désherber, récolter les champs,
que ce soit pour le tabac, la canne à sucre,
l'indigo ou le coton selon les régions et
les périodes. Dans la Caraïbe, en raison
des grandes plantations de sucre et de
tabac, les femmes esclavisées étaient
soumises à des conditions de travail
extrêmement difficiles et à des traitements
particulièrement brutaux. La dépendance
économique de la Caraïbe vis-à-vis de ces
cultures lucratives exigeait souvent une
exploitation encore plus intense et violente
des femmes esclavisées dans les champs
en raison de leur capacité à produire et à se
reproduire. Pendant l’esclavage et la traite
négrière, les corps de femmes africaines
asservies ont été cruellement torturés,
abusés sexuellement, enchaînés, écorchés
vifs, diabolisés, fragmentés, considérés
comme des outils de reproduction et
comme des biens commerciaux. Dans les
récits et les constructions socioculturelles
de la période esclavagiste, le corps de la
femme noire était représenté comme
l'antithèse du bien et du beau et comme
un corps-objet exploitable à souhait.
Néanmoins, les récits historiques associent
systématiquement les femmes noires à
leur force mythique, leur habileté, leur
capacité à résister continuellement face
Et maintenant regardez la
statue de René-Corail : c’est
une femme, une Négresse,
peut-être la Martinique,
qui, soutenant son enfant
blessé d’une main, peut-être
son enfant mort, brandit de
l’autre main une arme, elle
ne pleure pas, elle se bat [...].
Une grande Négresse, l’arme
à la main, maniant son
arme, comme ses ancêtres
la sagaie. Et bien cela,
c’est la vision martiniquaise
de la libération des Nègres.
Aimé Césaire, 22 mai 1971.
La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,
VIE DU DIOCÈSE
‘‘

Page 11
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 11
à l’adversité tout en protégeant leurs
progénitures nombreuses et en effectuant
des tâches aussi éreintantes que celles
de leurs homologues masculins dans
les champs. Selon l’historien barbadien
Hilary Beckles, la force mythique des
femmes d’ascendance africaine était
attribuée à leur héritage génétique, à la
masculinisation de leur morphologie et à
leur prétendue absence de sentiments et
de moralité (Beckles 1999: 135). Pourtant,
c’est bien leurs valeurs morales qui ont
limité les femmes dans leur pratique du
marronnage car ces dernières ne pouvaient
fuir en abandonnant leurs enfants. Dans
une analyse sur le marronnage, l’historien
afro-américain John Hope Franklin note
que la maternité est souvent perçue
comme un obstacle à la fuite, avec en
moyenne 81% d’hommes fugitifs, soit
environ 4 hommes pour une seule
femme. Loin d’être la manifestation d’un
manque de bravoure, les esclavisées ont eu
tendance à privilégier d’autres formes de
marronnages que la fuite, notamment les
tentatives d’empoisonnement, l’utilisation
des plantes médicinales, les infanticides,
vols, incendies, et autres formes de
sabotage. Les récits autobiographiques
de femmes esclavisées publiés à partir
du 19ème soulignent non seulement le
rôle central de la mère dans le maintien
du foyer et la préservation des ressources,
mais également les valeurs d’entraide, de
solidarité et de sororité comme piliers de
l’univers féminin de la plantation.
Pendant la période de l’esclavage, la
structure familiale était essentiellement
constituée de la mère et de ses enfants car
le mariage ne représentait pas un gage de
stabilité pour les femmes. Ces dernières
s’appuyaient davantage sur les relations
intergénérationnelles et la transmission
des valeurs et savoir-faire, généralement
de mère en fille (cuisinière, matrone,
accoucheuse, soignante par les plantes
médicinales, entre autres compétences).
Le marronnage féminin se manifestait dès
lors par le biais de multiples stratégies
détournées et silencieuses et par la mise
en œuvre d’un système de résistances
permettant la survie collective. En somme,
qu’elles aient été des guerrières fugitives
hors des plantations ou des mères
courageuses et stratèges à l’intérieur même
des habitations, les femmes esclavisées
ne peuvent pas être décrites comme de
simples victimes passives et soumises.
Comme leurs homologues masculins,
les négresses marronnes ont donc
indéniablement contribué au combat pour
la liberté, elles ont comploté pour mettre
fin au système esclavagiste, provoqué des
insurrections depuis les plantations et
imaginé des stratégies permettant la justice
et la survie de leur foyer. On comprend dès
lors le lien entre la figure héroïque de la
négresse marronne et celle de la femme
« poto-mitan », femme résiliente, mère
sacrificielle souvent seule en charge du
foyer face à des pères fuyants ou fugueurs
qui marronnent certainement eux aussi à
leur manière et en d’autres lieux, évitant
ainsi la charge du foyer. Désignant la
colonne cylindrique érigée au centre du
temple vodou haïtien, la symbolique de
la femme poto-mitan a fait son apparition
en Martinique plus d’un siècle après
l’abolition de l’esclavage, au milieu du 20
ème
siècle. Aujourd’hui décriée voire rejetée par
un certain nombre de groupes féministes
qui l’associent au fardeau de la domesticité
et de la charge mentale, la figure de la
femme poto-mitan n’en demeure pas
moins le symbole socioculturel de la force
et de la capacité de résilience des femmes.
Les stratégies de résistance deviennent
d’autant plus vitales dans le contexte
martiniquais actuel où plus de 40% des
familles sont monoparentales menées
majoritairement par des femmes (9 fois
sur 10) dont 39% vivent en dessous du seuil
de pauvreté, soit 6 familles sur 10 selon les
chiffres de l’INSEE en 2023.
De nombreuses femmes martiniquaises
dites « poto-mitan » pratiquent sans
doute à leur manière et malgré elles l’art
du marronnage au quotidien, en défiant
les oppressions capitalistes et sexistes,
en faisant preuve de débrouillardise, en
développant des systèmes de solidarité
familiale, en organisant des coups de mains,
des micro-crédits informels, en résistant
autrement et en réclamant sans relâche des
sociétés plus équitables. Par ailleurs, en ce
mois de mai, mois des commémorations
de l’abolition de l’esclavage en Martinique
obtenue suite aux révoltes des esclavisé.e.s
du 22 mai 1848, il semble opportun de relire
le discours
prononcé par
Aimé Césaire
cité en
préambule,
lors de
l’inauguration
de la statue
qui symbolise
la libération des
esclavisé.e.s, œuvre
réalisée par l’artiste
martiniquais Khôkhô René-Corail. Il y a
plus de cinquante ans en effet, le 22 mai
1971 à Trénelle, Fort-de-France, le chantre
de la Négritude affirmait publiquement
l’agentivité historique des femmes
esclavisées et la généalogie féminine de
la résistance martiniquaise, envisageant
ainsi une nouvelle grille de lecture du
marronnage contemporain par le prisme
du féminin. Il semble dès lors urgent de
repenser le mythe de la femme « poto-
mitan » à la lumière de l’histoire des luttes
anti-esclavagistes qu’il faut a fortiori
relier aux luttes contemporaines pour
les réparations des séquelles laissées
par l’esclavage. En définitive, il s’agirait
pour nous d’habiter la terre autrement, de
co-construire des systèmes plus efficients
de solidarité locale durable à l’attention
des familles en difficulté économique,
de nous engager collectivement et de
résister autrement. Il s’agit véritablement
pour nous de lutter pour la construction
d’un monde plus équitable au croisement
de la justice raciale, sociale, économique,
environnementale et de l’égalité hommes-
femmes car « il s'agit de la combativité de
celles et ceux qui ne renoncent jamais à
façonner la vie, à se charger du monde,
à inventer l'avenir ». (Christiane Taubira,
Nous habitons la Terre).
Myriam Moïse
Maître de conférences en études culturelles
Unité Mixte de Recherche PHEEAC
Pouvoir
•Histoire •Esclavage•
Environnement•
Atlantique•Caraïbe
CNRS, UMR8053
Université des Antilles,
Martinique.
Organisatrice du colloque
Caribbean Mundus :
Pouvoir, Histoire, Post-Esclavages,
23-25 mai 2024, Campus de
Schoelcher.
Contact : caribbeanmundus@gmail.com
■
Maître de conférences en études culturelles
Unité Mixte de Recherche PHEEAC
•
Pouvoir, Histoire, Post-Esclavages,

Page 12
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68212
A l'occasion des Chemins de mémoire, "Eglise en Martinique" s'est penché sur l'histoire de
la chapelle de Pontaléry au Robert. L'édifice actuel a été construit sur les fondations d'un
premier oratoire construit par des esclavisés en 1802, avec l'aide de l'abbé Champroux.
La première chapelle a été bénie le 14 août 1802. Des esclavisés l'auraient édifiée en
hommage à la Vierge Marie. Probablement détruite par le cyclone de 1891, elle aurait été
reconstruite 3 ans plus tard et dédiée à Saint Joseph.
L
'historienne Annick François-
Haugrin, présidente de la Société
des Amis des Archives de
Martinique, précise : " D'après un travail
réalisé par Emile Hayot, auteur passionné
d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,
aurait été construite à l'initiative de
l'Abbé Champroux (curé du Robert de
1794 à 1802). Ce prêtre était arrivé en
Martinique en 1794, occupée à l'époque
par les Anglais. Prêtre réfractaire, il
avait fui la France parce qu'il refusait
de prêter serment à la Constitution
civile du clergé, votée en 1790 et qui
obligeait les prêtres à reconnaître
les institutions révolutionnaires. En
1792, l'abbé Champroux se réfugie en
Angleterre, puis rejoint la Martinique
deux ans plus tard ". (cf "Histoire de
l'antiesclavagisme catholique en
Martinique", équipe Cap 170 sous la
direction de Annick François-Haugrin
publié par l'association diocésaine
de la Martinique).
En 1802, la Martinique repasse
sous la domination française.
L'abbé Champroux finit par prêter
serment à la Constitution. Mais le passage
en Martinique du prêtre réfractaire fut
de courte durée. Le mois d’octobre
de la même année, Dubuc de Rivery,
propriétaire terrien au Robert, porte
plainte auprès des autorités, contre
l'abbé, pour avoir construit un oratoire
réservé aux esclavisés, sur son habitation.
Le 3 novembre 1802, l'abbé Champroux
est expulsé de la Martinique.
L'oratoire construit en 1802 à Pontaléry,
dédié à la Vierge libératrice, portait
l'inscription : " Appui des esclaves, priez
pour nous ". L'origine du sanctuaire s'est
perdue et la chapelle construite après
le cyclone de 1891, a été dédiée à Saint-
Joseph.
Résidant au Robert
depuis de longues
années, Annick
François-Haugrin
se souvient de l'ac-
tion du père Zénon
à la fin des années
1990 pour redonner
vie à la chapelle. "
L'oratoire est sur un
terrain privé, il n'a
jamais été dans le
patrimoine du dio-
cèse, ni même de la
paroisse ", précise-
t-elle. " Autrefois,
les gens y allaient
assidûment. La chapelle Saint-Joseph
est restée lieu de culte très longtemps.
Après le départ du père Zenon, elle a
été à nouveau, laissée à l'abandon. Ça
serait bien de s'y intéresser de nouveau,
d'y faire des fouilles pour retrouver les
fondations de l'ancienne chapelle. En
Martinique, on a peu de lieu de souvenir
comme celui-ci".
Virginie Monlouis-Privat ■
La chapelle de Pontaléry,
lieu de mémoire
VIE DU DIOCÈSE
l'antiesclavagisme catholique en
Martinique", équipe Cap 170 sous la
direction de Annick François-Haugrin
publié par l'association diocésaine
de la Martinique).
d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,
L'abbé Champroux finit par prêter
d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,
sous la domination française.
d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,
direction de Annick François-Haugrin
publié par l'association diocésaine
de la Martinique).
depuis de longues
années, Annick
se souvient de l'ac-
tion du père Zénon
à la fin des années
vie à la chapelle. "
terrain privé, il n'a
jamais été dans le
cèse, ni même de la
t-elle. " Autrefois,

Page 13
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 13
La Pastorale de la culture de Rivière-Salée ■
Pour la 7
ème
année consécutive, la paroisse Saint-
Jean-Baptiste de Rivière-Salée organise un
programme de manifestations dans le cadre du
souvenir de l’esclavage et de son abolition. Ce
chemin de mémoire a pour vocation de rassembler
les paroissiens du diocèse mais aussi tous ceux qui
se sentent concernés par cette lutte historique.
P
our l’Église, c’est avant tout mettre en lumière l’action du Dieu intemporel,
un Dieu fidèle qui libère hier, aujourd’hui et demain.
Cette commémoration s’articule autour d’une dimension à la fois
spirituelle, historique et culturelle.
Cette année, l’accent sera mis sur les apports vestimentaires, le savoir-faire que
nous avons hérité de cette période de l’esclavage. L’habit créole, marqueur
social fort a été porté jusqu’au début du XX
e
siècle en Martinique. Les tenues
que portent les femmes créoles obéissent à des règles précises : elles vont
révéler leur histoire : leur âge, leur classe sociale, les circonstances et les mœurs.
La manifestation se déroulera selon le
programme suivant :
➊Mardi 21 mai 2024
17h30 :messe à l’église de Grand-
Bourg.
➋ 19h à 20h15 : Animation culturelle sur
le parvis de l’église avec la participation
d’artistes : Émile Pelti, Murielle Bedot,
Alfred Varasse, de Thierry Commin
du CVM (Collectif du Patrimoine
Vestimentaire Martiniquais).
➌ 20h30 :Marche aux flambeaux en
direction de l’église de Petit-Bourg sous
le signe du pardon, de la réconciliation et
de la guérison dans nos familles et entre
nos communautés (bus pour le retour).
➍ 21h à 6h :Exposition de Saint sacrement
à l’église de Petit-Bourg.
➎ Mercredi 22 mai 2024
7h :Messe en créole à l’église de Petit-
Bourg.
Commémoration de l’abolition de l’esclavageCommémoration de l’abolition de l’esclavage
à la paroisse de Rivière-Saléà la paroisse de Rivière-Saléee
du mardi 21 mai au mercredi 22 mai 2024
Sonjé, prédjé é adoré
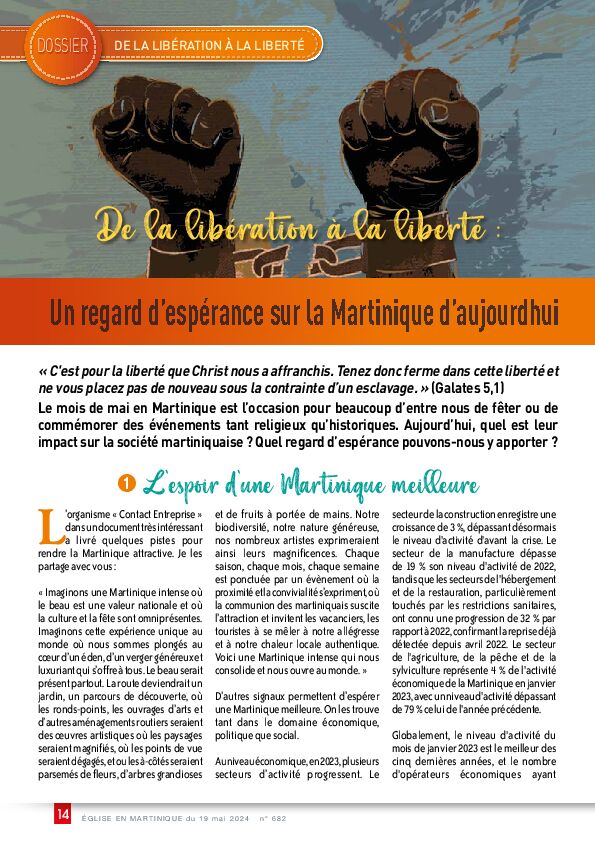
Page 14
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68214
Un regard d’espérance sur la Martinique d’aujourdhui
De la libération à la liberté :
DE LA LIBÉRATION À LA LIBERTÉDOSSIER
« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et
ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage. »
(Galates 5,1)
Le mois de mai en Martinique est l’occasion pour beaucoup d’entre nous de fêter ou de
commémorer des événements tant religieux qu’historiques. Aujourd’hui, quel est leur
impact sur la société martiniquaise ? Quel regard d’espérance pouvons-nous y apporter ?
➊L’espoir d’une Martinique meilleure
L
’organisme « Contact Entreprise »
dans un document très intéressant
a livré quelques pistes pour
rendre la Martinique attractive. Je les
partage avec vous :
« Imaginons une Martinique intense où
le beau est une valeur nationale et où
la culture et la fête sont omniprésentes.
Imaginons cette expérience unique au
monde où nous sommes plongés au
cœur d’un éden, d’un verger généreux et
luxuriant qui s’offre à tous. Le beau serait
présent partout. La route deviendrait un
jardin, un parcours de découverte, où
les ronds-points, les ouvrages d’arts et
d’autres aménagements routiers seraient
des œuvres artistiques où les paysages
seraient magnifiés, où les points de vue
seraient dégagés, et ou les à-côtés seraient
parsemés de fleurs, d’arbres grandioses
et de fruits à portée de mains. Notre
biodiversité, notre nature généreuse,
nos nombreux artistes exprimeraient
ainsi leurs magnificences. Chaque
saison, chaque mois, chaque semaine
est ponctuée par un évènement où la
proximité et la convivialité s’expriment, où
la communion des martiniquais suscite
l’attraction et invitent les vacanciers, les
touristes à se mêler à notre allégresse
et à notre chaleur locale authentique.
Voici une Martinique intense qui nous
consolide et nous ouvre au monde. »
D’autres signaux permettent d’espérer
une Martinique meilleure. On les trouve
tant dans le domaine économique,
politique que social.
Au niveau économique, en 2023, plusieurs
secteurs d’activité progressent. Le
secteur de la construction enregistre une
croissance de 3 %, dépassant désormais
le niveau d'activité d'avant la crise. Le
secteur de la manufacture dépasse
de 19 % son niveau d'activité de 2022,
tandis que les secteurs de l'hébergement
et de la restauration, particulièrement
touchés par les restrictions sanitaires,
ont connu une progression de 32 % par
rapport à 2022, confirmant la reprise déjà
détectée depuis avril 2022. Le secteur
de l'agriculture, de la pêche et de la
sylviculture représente 4 % de l'activité
économique de la Martinique en janvier
2023, avec un niveau d'activité dépassant
de 79 % celui de l'année précédente.
Globalement, le niveau d'activité du
mois de janvier 2023 est le meilleur des
cinq dernières années, et le nombre
d'opérateurs économiques ayant

Page 15
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 15
A
près de longs mois de luttes
et de révoltes acharnées, une
simple plume a transformé à tout
jamais le statut juridique de l’Homme noir
esclave1. Il passe dès lors de la condition
d’objet mobilier, n’ayant pas plus de
valeur qu’une simple chose inerte, telle
une table ; à un être humain à part entière,
un citoyen de la République française,
ayant des droits, des devoirs et des
obligations. Cette première libération a
un effet retentissant sur la communauté.
Elle est le Saint Graal d’une liberté tant
attendue et tant espérée.
En pratique, cette dénomination nouvelle
de l’esclave libre de 1848, reste tout de
même abstraite sur un territoire construit
pour l’essentiel sur la hiérarchisation
des classes sociales et sur des préjugés
abjects lesquels transcendent à
l’époque tout décret institutionnel. Face
à ces nombreux souffles discriminants,
la doctrine républicaine de l’intégration
2
de la population martiniquaise à celle de
la population de la France hexagonale
ne faiblit pas, bien au contraire. Une
multitude d’actions émerge afin que
soient véritablement reconnus les droits
et devoirs tant désirés par une population
trop longtemps bafouée.
De la représentation des Antilles au
Parlement (décret du 8 septembre 1870),
en passant par la départementalisation
(loi n°46-451 du 19 mars 1946) puis à la
promulgation de la loi dite Taubira
(loi n°2001-434 du 10 mai
2001) érigeant l’esclavage
au rang de crime contre
l’humanité, d’éminentes figures politiques
et intellectuelles n’ont jamais cessé de
militer pour l’amélioration des conditions
de vie de la population martiniquaise.
Tant qu’il y aura des hommes et des
femmes soucieux d’avoir un impact positif
et novateur dans le développement
et l’accroissement économique, social
et politique de la Martinique, celle-ci
continuera son évolution vers un
rayonnement international plus fort.
Julie Rapon ■
déposé leur déclaration de chiffre
d'affaires est en constante augmentation
depuis les trois dernières années, ce
qui permet de confirmer un rattrapage
de l'activité, voire un dépassement
des performances économiques
quantitatives comparativement aux
années précédentes, y compris celle
antérieure à la crise. Cette tendance
encourageante reflète le dynamisme
économique de la Martinique et laisse
entrevoir un avenir prometteur pour l'île
caribéenne.
Au niveau politique, des initiatives sont
prises pour le retour au pays des jeunes
martiniquais. En effet, en 2040, si rien
ne change, la Martinique deviendra un
territoire bordé d’eau turquoise, à la
biodiversité entretenue, aux paysages
luxuriants ou urbains mais dépeuplés,
privé de joie de vivre et d’entreprendre,
habité de souvenirs et de désamour.
Y vivra une population appauvrie et
vieillissante, entourée de nostalgie et
d’Histoire. L’avenir institutionnel de la
Martinique que certains appellent de
leurs vœux peut être une solution mais
pas la seule même si le congrès des élus
en 2023 a abordé des sujets touchant
à la vie quotidienne de la population
martiniquaise entre autres : coût de
la vie, insécurité, crise économique,
transport collectif, santé, eau, transition
énergétique, gestion des déchets.
Au niveau social, malgré des mouvements
de grève qui durent en longueur à
cause d’incompréhensions
et parfois frisent la vio-
lence, les négociations
souvent sous l’égide
de professionnels
(Inspecteurs du tra-
vail, médiateurs…)
permettent de trou-
ver un terrain d’en-
tente privilégiant le
dialogue et le compro-
mis.
Au niveau culturel, on assite à retour
aux sources à travers les danses du pays
le « bèlè » notamment. Mais d’autres
musiques sont mises en valeur : zouk,
jazz, rap… Beaucoup d’artistes font la
fierté de la Martinique dans l’hexagone
et dans le monde.
En guise de conclusion, je reprends celle
figurant dans Martinique attractive et
qui reste d’actualité : « Les projets ne
manquent pas. Le temps n’est plus à la
diplomatie. Les hommes d’actions sont
demandés. L’audace et le courage
sont requis. Il faut inventer le
futur et le diriger vers une
Martinique enracinée
et contemporaine,
historique et connectée.
C’est l’affaire de tous
afin de construire ce
XXI
ème
siècle attractif et
humaniste. »
Yves-Marie G. ■
cause d’incompréhensions
et parfois frisent la vio-
lence, les négociations
tente privilégiant le
dialogue et le compro-
demandés. L’audace et le courage
sont requis. Il faut inventer le
futur et le diriger vers une
Martinique enracinée
et contemporaine,
XXI
humaniste. »
du 19 mai 2024 – n° 682 15
promulgation de la loi dite Taubira
(loi n°2001-434 du 10 mai
2001) érigeant l’esclavage
au rang de crime contre
A
près de longs mois de luttes abjects lesquels transcendent à l’humanité, d’éminentes figures politiques
➋Une amélioration des conditions de vie en Martinique
2
Article 6 de la Constitution du 5 fructidor an II
dispose que « les colonies seront soumises à la même
loi constitutionnelle que le territoire de la métropole ».
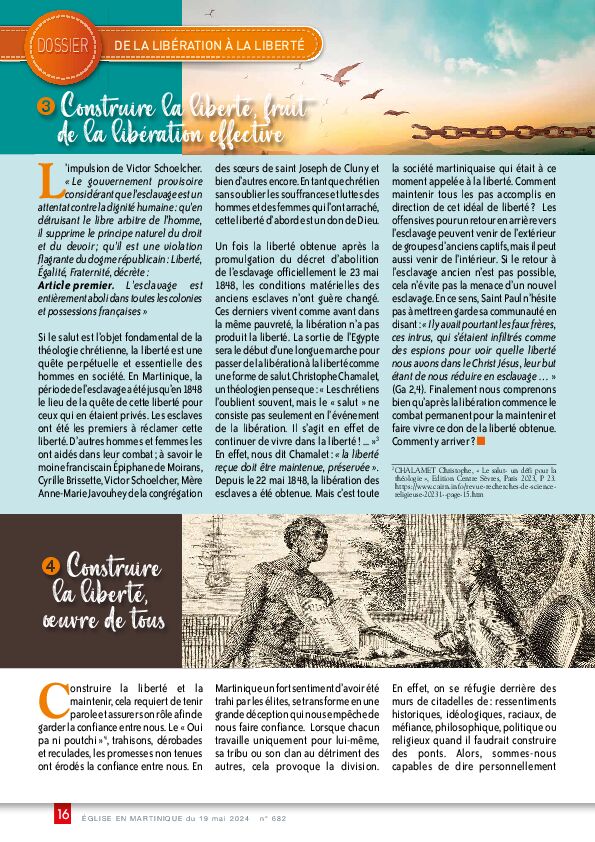
Page 16
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68216
DE LA LIBÉRATION À LA LIBERTÉDOSSIER
➌Construire la liberté, fruit
de la libération effective
L
’impulsion de Victor Schoelcher.
« Le gouvernement provisoire
considérant que l'esclavage est un
attentat contre la dignité humaine : qu'en
détruisant le libre arbitre de l'homme,
il supprime le principe naturel du droit
et du devoir ; qu'il est une violation
flagrante du dogme républicain : Liberté,
Égalité, Fraternité, décrète :
Article premier. L'esclavage est
entièrement aboli dans toutes les colonies
et possessions françaises »
Si le salut est l’objet fondamental de la
théologie chrétienne, la liberté est une
quête perpétuelle et essentielle des
hommes en société. En Martinique, la
période de l’esclavage a été jusqu’en 1848
le lieu de la quête de cette liberté pour
ceux qui en étaient privés. Les esclaves
ont été les premiers à réclamer cette
liberté. D’autres hommes et femmes les
ont aidés dans leur combat ; à savoir le
moine franciscain Épiphane de Moirans,
Cyrille Brissette, Victor Schoelcher, Mère
Anne-Marie Javouhey de la congrégation
des sœurs de saint Joseph de Cluny et
bien d’autres encore. En tant que chrétien
sans oublier les souffrances et luttes des
hommes et des femmes qui l’ont arraché,
cette liberté d’abord est un don de Dieu.
Un fois la liberté obtenue après la
promulgation du décret d’abolition
de l’esclavage officiellement le 23 mai
1848, les conditions matérielles des
anciens esclaves n’ont guère changé.
Ces derniers vivent comme avant dans
la même pauvreté, la libération n’a pas
produit la liberté. La sortie de l’Egypte
sera le début d’une longue marche pour
passer de la libération à la liberté comme
une forme de salut. Christophe Chamalet,
un théologien pense que : « Les chrétiens
l’oublient souvent, mais le « salut » ne
consiste pas seulement en l’événement
de la libération. Il s’agit en effet de
continuer de vivre dans la liberté ! ... »
3
En effet, nous dit Chamalet : « la liberté
reçue doit être maintenue, préservée ».
Depuis le 22 mai 1848, la libération des
esclaves a été obtenue. Mais c’est toute
la société martiniquaise qui était à ce
moment appelée à la liberté. Comment
maintenir tous les pas accomplis en
direction de cet idéal de liberté ? Les
offensives pour un retour en arrière vers
l’esclavage peuvent venir de l’extérieur
de groupes d’anciens captifs, mais il peut
aussi venir de l’intérieur. Si le retour à
l’esclavage ancien n’est pas possible,
cela n’évite pas la menace d’un nouvel
esclavage. En ce sens, Saint Paul n’hésite
pas à mettre en garde sa communauté en
disant : « Il y avait pourtant les faux frères,
ces intrus, qui s’étaient infiltrés comme
des espions pour voir quelle liberté
nous avons dans le Christ Jésus, leur but
étant de nous réduire en esclavage … »
(Ga 2,4). Finalement nous comprenons
bien qu’après la libération commence le
combat permanent pour la maintenir et
faire vivre ce don de la liberté obtenue.
Comment y arriver ?
■
2
CHALAMET Christophe, « Le salut- un défi pour la
théologie », Edition Centre Sèvres, Paris 2023, P 23.
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-
religieuse-20231--page-15.htm
C
onstruire la liberté et la
maintenir, cela requiert de tenir
parole et assurer son rôle afin de
garder la confiance entre nous. Le « Oui
pa ni poutchi »
4
, trahisons, dérobades
et reculades, les promesses non tenues
ont érodés la confiance entre nous. En
Martinique un fort sentiment d’avoir été
trahi par les élites, se transforme en une
grande déception qui nous empêche de
nous faire confiance. Lorsque chacun
travaille uniquement pour lui-même,
sa tribu ou son clan au détriment des
autres, cela provoque la division.
En effet, on se réfugie derrière des
murs de citadelles de : ressentiments
historiques, idéologiques, raciaux, de
méfiance, philosophique, politique ou
religieux quand il faudrait construire
des ponts. Alors, sommes-nous
capables de dire personnellement
➍Construire
la liberté,
œuvre de tous

Page 17
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 17
« Je » et collectivement « nous »
sommes responsables pour conserver
ce don de la liberté ? En réalité, la
liberté dans une société n'est pas
seulement une affaire de spécialistes
capable de l’organiser, mais il nous
revient chacun ensemble de la faire
fructifier en Jésus-Christ mais aussi
avec les hommes et les femmes de
bonne volonté qui partagent ce même
idéal. Nous le savons nous naviguons
dans le même bateau, dans la même
yole. La réussite sera collective, l’échec
aussi. Dans le livre de l’Exode, sur la
montagne, Dieu a parlé à son peuple, il
a donné à Moïse les tables de la loi et a
fait alliance avec Israël, de même qu’au
moment de la libération des esclaves
en 1948, Dieu fait alliance avec toute
la société Martiniquaise. Il lui a donné
la liberté en héritage.
En Martinique, avons-nous conscience
de la nécessité de faire peuple avec
l’exigence de devoir rester fidèle à
cette alliance autour de la valeur de la
liberté. Une alliance scellée dans les
larmes, la sueur et le sang des esclaves,
des hommes et des femmes qui ont su
susciter l’espérance et l’héritage d’une
nouvelle manière heureuse de vivre
dans ce pays. Une alliance entre nous
dans le respect de nos différences et
non pas de la racialisation à outrance
des problèmes jusqu’à la racialisation de
l’identité collective. Il est vrai que brandir
les blessures de l’esclavage comme
étendard est une stratégie politique qui
fonctionne bien à la Martinique. Aucun
peuple ne peut refaire son histoire. On ne
refait pas son passé. Alors, mettons notre
force, notre âme, notre intelligence à faire
de notre histoire une force et non pas un
handicap. Il faut dire que le préjugé de
couleur a encore la vie dure chez nous.
Mais nous, il nous faut en sortir. Sacraliser
la blessure du passé, rappeler l’enfer et
être amère sans évoquer la perspective
d’un bonheur avenir en commun ne nous
mènent à rien. Il nous faut sortir d’un
mode de penser passéiste qui nous fait
tourner en rond dans le ressentiment
et la rage et qui nous conduit à l’échec.
Tout projet de société doit être bâti
sur les forces de la communauté et sa
vision de la réussite et non pas sur ses
blessures et les drames du passé. Face
à notre histoire, il faudrait que nous
commencions par nous valoriser à nos
propres yeux, nous aimer nous-mêmes
et retrouver une âme collective.
■
4
Dire « Oui » ne nécessite pas de se justifier
L
a Martinique est dans l’histoire du
monde actuel telle qu’elle s’écrit
et doit avoir une claire vision de
ce qu’elle est dans son identité et ce
qu’elle veut pour les générations futures.
Ce sera le dialogue, la recherche de la
vérité, le pardon et la réconciliation
ou bien la revanche et le chaos. Nous
le savons qu’après une libération, il
n’y a pas de liberté sans engagement
autour des projets concrets qui
répondent aux besoins quotidiens de
la population. Il faut également des
symboles constructifs qui unissent le
pays au lieu de continuer à séparer les
martiniquais car il est urgent de faire
communauté. Sommes-nous conscients
que le passage de la libération à la
liberté engage notre responsabilité
personnelle et collective ? La liberté
est un don de Dieu qui se construit
dans l’histoire où chacun a son rôle à
jouer. N’avons-nous pas tout intérêt à
rassembler nos forces, notre énergie et
mettre toute notre âme dans un projet
commun utile pour travailler et réussir
ensemble sans exclure personne au lieu
de continuer à se diviser ? C’est notre
mission de chrétiens, mission d’hommes
et de femmes de bonne volonté que
d’écrire le projet d’une société apaisée
débarrassée de tous les blocages issus
de notre passé encore présents dans
nos têtes et dans nos cœurs. En effet,
malgré la libération de1848 en regardant
aujourd’hui, nous pouvons voir que
certaines manières de penser et de
parler peuvent toujours nous maintenir
dans de nouvelles formes d’esclavages
parce que nous ne sommes pas encore
arrivés à déracialiser notre vision du
pays y compris dans son identité et sa
culture. Alors, changeons notre regard
de méfiance entre nous en Martinique
en un regard confiant et bienveillant.
Disons stop aux purificateurs et aux
séparatistes. Il suffit de faire un pas les
uns vers les autres, un pas dans l’écoute
et le dialogue, un pas dans la vérité,
un pas chaque jour pour continuer à
marcher après la libération vers une
vraie liberté qui construit l’unité en
Martinique.
4
Dire « Oui » ne nécessite pas de se justifier
Père Benjamin François-Haugrin ■
➎La liberté,
œuvre de confiance
réciproque

Page 18
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68218
?
QuestionAN TJÈ
LÉGLIZ-LA
La place des femmes au sein de la société voire de l’Eglise
suscite de nombreuses discussions, voire des oppositions.
Père Jean-Michel Monconthour répond à quelques questions.
A Quelle place la Bible donne-t-elle
à la femme ?
S
elon le livre de la Genèse au
chapitre 1, la femme et l’homme sont
créés à l’image et à la ressemblance
de Dieu. La femme est donc partenaire
de Dieu et de l’homme. L’homme et la
femme sont des collaborateurs de Dieu.
Considérée comme la mère des vivants
(Genèse 3), elle est co-responsable
de la création avec Adam, et plus
particulièrement de l’engendrement de
l’humanité. Souvent valorisée comme
épouse, elle doit développer des activités
internes à la maisonnée mais également
des activités sociales qui la valorisent,
elle, mais également son époux. Le Livre
des proverbes, au chapitre 31, décrit la
femme courageuse, comme ayant plus
de valeur que des bijoux.
c Dans Genèse, 2. 18, il est dit « ce
n’est pas bon que l’homme soit
seul, je vais lui donner une aide ».
N'est-ce pas donner à la femme une
seconde place ?
Dans les sociétés sexistes, voire
misogynes, la femme est rétrogradée au
second plan, comme une servante de
l’homme.
Si l’on considère la femme comme une
aide, elle viendrait donc après l’homme
et pourrait être considérée comme une
esclave qui doit soumission à son mari.
En réalité cette aide doit être vue comme
l’absolue nécessité de la femme pour
que l’homme existe lui-même. A travers
la relation homme/femme, l’humanité
peut advenir. Cette dernière a besoin de
l’autorité féminine comme de l’autorité
masculine, chacune devant faire place à
l’autre, pour le bien de tous. A travers
la femme, comme une aide, c’est Dieu
lui-même qui vient au secours de
l’homme comme refuge, comme
rempart pour permettre l’union, le
rassemblement. Il y a une intimité
naturelle entre la femme et Dieu.
t Dieu a créé deux êtres à sa
ressemblance, et pourtant ils sont
différents. Pourquoi ?
Ils sont différents et semblables tout à la
fois. Ils sont humains à la ressemblance
de Dieu, et ensemble ils dominent la terre.
La différence crée l’altérité pour pouvoir
avancer, travailler et évoluer. Elle dit,
également, que l’homme a en lui le désir
de Dieu. L’altérité radicale est Dieu, le
tout autre. Cette différence entre l’homme
et la femme est fondatrice de la relation
qui fait l’humanité.
Cette différence permet à la femme
d’être une force auprès de l’homme, sa
partenaire égale, il n’est pas seul. Elle
le complète en quelque sorte dans sa
mission et sa fécondité. Il n’y a pas de
supériorité, mais de l’unité puisqu’ils
partagent la même chair, la même nature,
le même destin.
e Nous avons en tête, que le péché
est arrivé par la femme. Est-elle plus
coupable que l'homme ?
Il ne s’agit pas de rechercher des
responsabilités destinées à culpabiliser
la femme. L’humanité (c’est-à-dire
l’homme et la femme) est coupable du
péché. Saint Paul dit que le péché est
entré dans le monde par Adam. Hommes
et femmes sont donc solidaires sur cette
question.
Notez bien qu’Eve est présentée
comme la vivante dont la descendance
meurtrira la tête du serpent et sa capacité
d’enfantement défiera la mort.
Par ailleurs, un parallèle a été établi entre
Eve et la Vierge Marie qui est également
considérée comme la nouvelle Eve. La
femme conçue sans péché, mère de Jésus
Sauveur, ayant dit « oui » au Père pour le
salut du monde.
s Aujourd'hui, la femme tient-
elle pleinement son rôle au sein
de l'Eglise ? Y a-t-il équité ? ou
soumission ?
Les femmes ont pleinement leur place
dans la vie religieuse, dans l’éducation,
elles sont formatrices, catéchistes. Elles
assument leur rôle au sein des conseils
paroissiaux et sont aussi ministres
extraordinaires de la Parole et de la
communion.
Certes, elles sont plus nombreuses que les
hommes, mais elles assurent leur mission
de baptisées. Il reste à opérer, dans nos
esprits, un changement de mentalité. Il ne
faut pas que les clans séparant hommes
et femmes qui existent au sein de la
société antillaise, se reproduisent au sein
de l’Eglise. Une juste considération des
uns et des autres, quels que soient leur
sexe, leur âge, ou autres différences,
doit s’instituer pour qu’il y ait une belle
communion.
Propos recueillis par Nicole Chésimar■
La place des femmes au sein de la société voire de l’Eglise
Dieu a créé deux êtres à sa
ressemblance, et pourtant ils sont
Ils sont différents et semblables tout à la
fois. Ils sont humains à la ressemblance
Femmes dans l’Église
‘‘
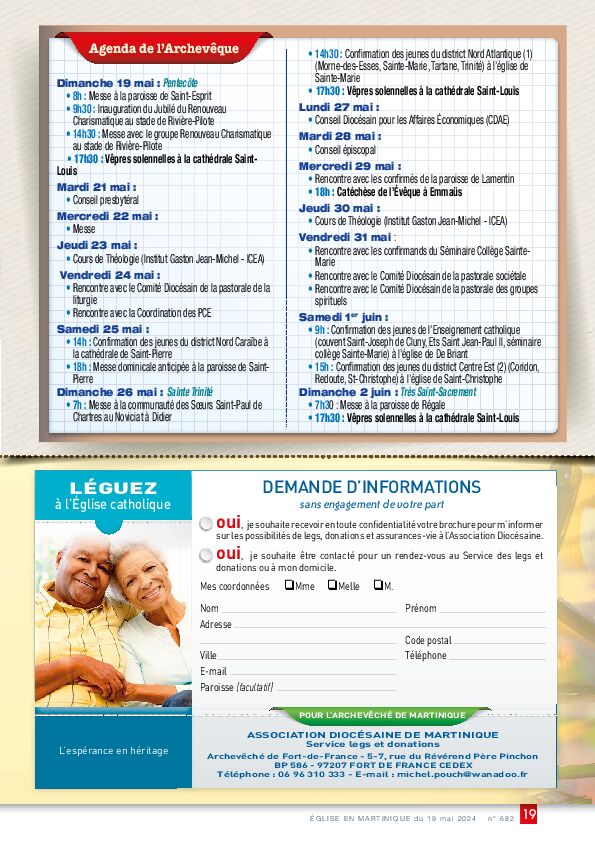
Page 19
ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 19
Agenda de l’Archevêque
Dimanche 19 mai : Pentecôte
• 8h : Messe à la paroisse de Saint-Esprit
• 9h30 : Inauguration du Jubilé du Renouveau
Charismatique au stade de Rivière-Pilote
• 14h30 : Messe avec le groupe Renouveau Charismatique
au stade de Rivière-Pilote
• 17h30 : Vêpres solennelles à la cathédrale Saint-
Louis
Mardi 21 mai :
• Conseil presbytéral
Mercredi 22 mai :
• Messe
Jeudi 23 mai :
• Cours de Théologie (Institut Gaston Jean-Michel - ICEA)
Vendredi 24 mai :
• Rencontre avec le Comité Diocésain de la pastorale de la
liturgie
• Rencontre avec la Coordination des PCE
Samedi 25 mai :
• 14h : Confirmation des jeunes du district Nord Caraïbe à
la cathédrale de Saint-Pierre
• 18h : Messe dominicale anticipée à la paroisse de Saint-
Pierre
Dimanche 26 mai : Sainte Trinité
• 7h : Messe à la communauté des Sœurs Saint-Paul de
Chartres au Noviciat à Didier
• 14h30 : Confirmation des jeunes du district Nord Atlantique (1)
(Morne-des-Esses, Sainte-Marie, Tartane, Trinité) à l’église de
Sainte-Marie
• 17h30 :Vêpres solennelles à la cathédrale Saint-Louis
Lundi 27 mai :
• Conseil Diocésain pour les Affaires Économiques (CDAE)
Mardi 28 mai :
• Conseil épiscopal
Mercredi 29 mai :
• Rencontre avec les confirmés de la paroisse de Lamentin
• 18h :Catéchèse de l’Évêque à Emmaüs
Jeudi 30 mai :
• Cours de Théologie (Institut Gaston Jean-Michel - ICEA)
Vendredi 31 mai :
• Rencontre avec les confirmands du Séminaire Collège Sainte-
Marie
• Rencontre avec le Comité Diocésain de la pastorale sociétale
• Rencontre avec le Comité Diocésain de la pastorale des groupes
spirituels
Samedi 1
er
juin :
• 9h : Confirmation des jeunes de l’Enseignement catholique
(couvent Saint-Joseph de Cluny, Ets Saint Jean-Paul II, séminaire
collège Sainte-Marie) à l’église de De Briant
• 15h : Confirmation des jeunes du district Centre Est (2) (Coridon,
Redoute, St-Christophe) à l’église de Saint-Christophe
Dimanche 2 juin : Très Saint-Sacrement
• 7h30 : Messe à la paroisse de Régale
• 17h30 : Vêpres solennelles à la cathédrale Saint-Louis
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE MARTINIQUE
Service legs et donations
Archevêché de Fort-de-France - 5-7, rue du Révérend Père Pinchon
BP 586 - 97207 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : 06 96 310 333 - E-mail : michel.pouch@wanadoo.fr
oui, je souhaite recevoir en toute confidentialité votre brochure pour m’informer
sur les possibilités de legs, donations et assurances-vie à l’Association Diocésaine.
oui,je souhaite être contacté pour un rendez-vous au Service des legs et
donations ou à mon domicile.
LÉGUEZ
à l’Église catholique
L’espérance en héritage
DEMANDE D’INFORMATIONS
sans engagement de votre part
Mes coordonnées ❏Mme ❏Melle ❏M.
Nom Prénom
Adresse
Code postal
Ville Téléphone
E-mail
Paroisse
(facultatif)
POUR L’ARCHEVÊCHÉ DE MARTINIQUE