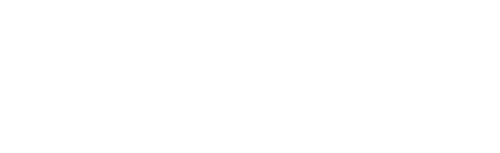étendue, marquée par des rituels qui précédaient, accompagnaient et suivaient la mise en
terre.
Loin de se limiter à un moment de tristesse, cette période constituait un véritable temps communautaire où l'on célébrait la mémoire du disparu. L'ensemble du voisinage et parfois même des quartiers entiers se mobilisaient, manifestant ainsi une solidarité bien différente des usages observés en métropole.
Il fut une époque pas si lointaine que cela en Martinique lorsque quelqu'un décédait, on faisait résonner la conque de Lambi selon un code particulier pour diffuser la nouvelle. Aussitôt informés, parents, amis et voisins convergeaient vers la demeure du défunt, apportant avec eux ce qui était nécessaire : bougies, étoffes, draps, pétrole, café et autres denrées.
Selon la coutume, la famille endeuillée ne devait pas se charger des préparatifs ; la communauté se répartissait spontanément les différentes tâches pour organiser la veillée funèbre et les obsèques. Les préparatifs suivaient des règles précises transmises de génération en génération : Les femmes prenaient en charge l'organisation : rangement minutieux de la maison, recouvrement des miroirs par des draps blancs, préparation de la couche mortuaire où reposerait le corps. L'habitation était balayée à l'intérieur comme à l'extérieur, mais les détritus n’étaient évacués qu'après l'inhumation du défunt. Pour maintenir le corps dans une position digne, on disposait une planche sur le matelas. Le défunt y demeurait jusqu'au moment de la mise en bière.
Contrairement à certaines pratiques visant à éloigner les vivants de la mort, la tradition en Martinique encourageait ceux qui en avaient peur, notamment les enfants, à enjamber la dépouille. On ne dissimulait pas le corps aux regards. La toilette rituelle était effectuée avec une eau agrémentée d'herbes aromatiques. Elle était confiée à une personne du même sexe que le défunt. Ensuite, on enduisait le corps d'un mélange composé de cire de chandelle, de café grillé et moulu, ainsi que de clous de girofle. Le mort était revêtu de ses plus beaux habits, souvent neufs et préparés de son vivant, ou confectionnés pour l'occasion par une couturière du coin. Comme il n’y avait pas d'entreprises de pompes funèbres, les familles prévoyantes conservaient sous leur toiture des planches destinées à la fabrication du cercueil. A cette époque, croyait que des effets personnels du défunt mis dans son cercueil, garantissaient sa sérénité et son passage paisible vers l'au-delà.
La veillée funèbre était une sorte de célébration nocturne réunissant proches, amis et membres de la communauté pour honorer la mémoire du disparu. Dans la maison, des personnes pieuses récitaient litanies et chapelets durant de longues heures. Chaque arrivant saluait le mort en traçant un signe de croix avec un rameau plongé dans l'eau bénite. Dehors, sous la lumière des bougies, l'atmosphère prenait un caractère festif avec les roulements des tambours et les récits des conteurs. Ces derniers évoquaient le parcours du défunt, partageant souvenirs, anecdotes, qualités comme défauts, entremêlés de contes traditionnels en créoles.
L'inhumation se déroulait le jour suivant la veillée. Après la cérémonie religieuse, la famille était raccompagnée, entourée d'une chaîne de solidarité. Pour assurer le repos éternel du défunt, des prières étaient récitées pendant les neuf jours consécutifs à l'enterrement.
Quarante jours après le décès, une messe pouvait être célébrée à la demande de la famille pour le repos de l'âme du disparu. Des conventions strictes régissaient la durée et les manifestations extérieures du deuil. La perte d'une mère imposait trois années de deuil : deux ans vêtus de noir, en tenue colletée et à manches longues, suivis d'une année en blanc, noir et violet. Pour un père, la période s'établissait à deux ans. Le deuil d'un époux ou d'autres membres de la famille s'étendait sur une année. Ces pratiques ancestrales témoignaient d'une conception communautaire de la mort et du deuil, où l'accompagnement collectif permettait à chacun de traverser l'épreuve de la séparation dans un esprit de solidarité et de mémoire partagée.
Aujourd’hui, l'Église et les acteurs de la pastorale de la santé sont confrontés à un double défi : préserver les aspects bénéfiques des traditions ancestrales, surtout le soutien communautaire et le temps nécessaire au travail de deuil, tout en accompagnant les évolutions inévitables de la société moderne. Certaines initiatives, comme les veillées de consolation au CHU ou les groupes de prière pour les défunts, tentent de recréer ces espaces d'accompagnement collectif qui risquent de disparaître. Il s'agit de maintenir vivante cette sagesse traditionnelle qui reconnaissait dans le deuil non pas une faiblesse à dissimuler, mais un passage nécessaire à traverser ensemble, dans la foi et l'espérance de la Résurrection.
La question demeure : comment garder l'esprit communautaire et solidaire des traditions d'autrefois dans un monde où l'individualisme et la rapidité tendent à isoler les personnes endeuillées dans leur douleur ?
Ève-Lyne ■
Dans la même catégorie
-
 Lundi03/11
Lundi03/11La communion des saints dans les religions chrétiennes
« Je crois à la communion des saints » affirmons-nous dans le Credo récité par la plupart des confessions chrétiennes : la communion des saints est [...]
Diocèse de Martinique
Pastorale -
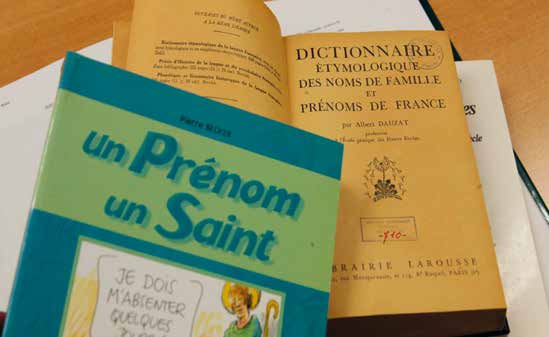 Lundi03/11
Lundi03/11Mon Prénom, mon Histoire sainte
En ce monde contemporain, les parents chrétiens cherchent des prénoms extraordinaires à donner aux enfants
Diocèse de Martinique
Pastorale -
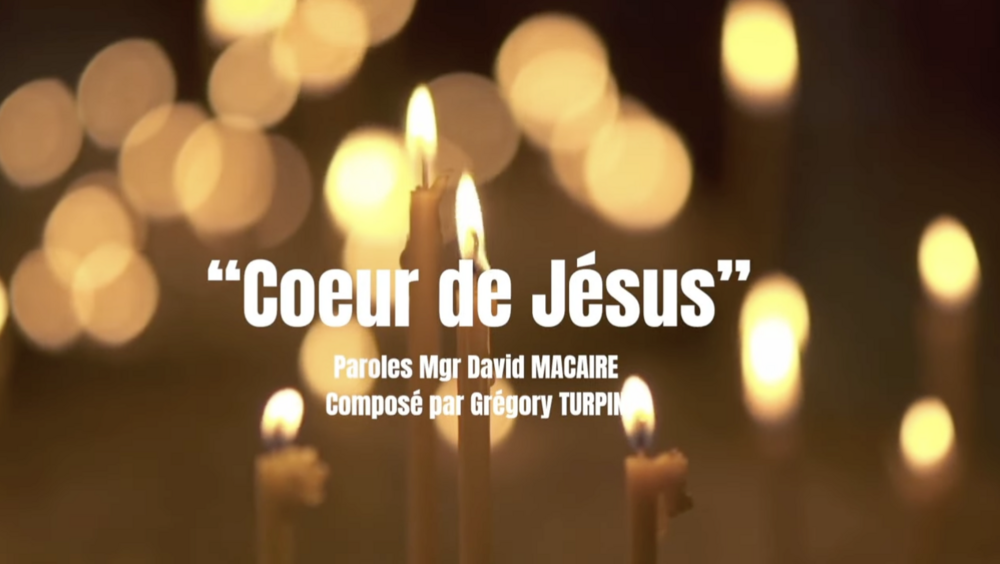 Lundi03/11
Lundi03/11Clip vidéo du chant diocésain " Coeur de Jésus" composé pour la consécration au Sacré Coeur de notre diocèse
À l’occasion de la sortie du film Sacré-Cœur, actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma de Martinique, le diocèse est heureux d’annoncer la [...]
Diocèse de Martinique
Pastorale