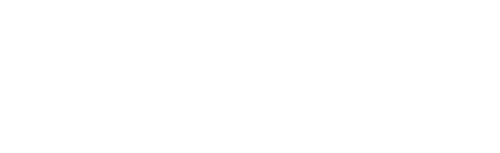Mais de façon plus idiomatique, le « Gwopwal » désigne un homme ou une femme qui, suit à une déception violente (amoureuse le plus souvent), un choc affectif, un évènement traumatisant, a perdu goût à la vie, se laisse aller aux passions tristes, le dépit, la tristesse, l’amertume ou la colère. Ce n’est pas une personne paresseuse, mais quelqu’un qui ne voit plus par quel moyen surmonter l’épreuve. Le ou les chocs ont été si violents que tout passé se meut en blessure, tout futur devient angoisse, toute relation se colore de méfiance, toute parole perd son sens, tout acte de foi ou d’espérance semble vain, tout mouvement se déroule au ralenti, toute pensée est lasse, tout songe tourne au cauchemar, tout projet semble une impasse, toute amitié pran lavol, … Dépression, débauche et débordements sont les symptômes du « Gwopwal ».
Les anciens moines appelaient ça « le démon de l’acédie ». De fait, c’est ce démon, très reconnaissable, qui conduit au suicide. Il est connu depuis des siècles, mais, en raison de son étrange capacité à susciter des attitudes opposées, il sait se cacher. Il reste invisible aux radars de la politique, de la sociologie ou de la psychologie qui tentent en vain depuis des décennies d’en compenser les effets…
Et pour cause : bien qu’elle ait des racines en tous ces domaines et y porte également ses fruits, l’acédie est une réalité principalement spirituelle. C’est d’abord un esprit mauvais qui exerce vexations et oppressions et fait feu de tout bois pour ronger l’âme humaine.
Chez nous, ce démon, si bien repéré par la sagesse antillaise sous le nom de « Gwopwal », possède une particularité : issu d’une même porte ouverte dans notre histoire inconsciente commune, il s’apparente à un atavisme, il s’enracine dans l’inconscient collectif. Nous avons, tous ensemble, un « Gwopwal », un bon gros « GP ». Ce ne sont pas seulement plusieurs d’entre nous qui sommes mordus par ce serpent au gré de nos existences individuelles, mais tout notre peuple. Une seule et même tristesse provoque çà et là colère, déception, frayeur, esprit de suicide collectif, dégoût, vulgarité, envie de tout casser, de crier, de hurler, de faire mal, de se faire mal, de dire « je vais mal », de partir, de fuir, de laisser tomber ou encore, fringale de consommer, de remplir sa maison, son ventre ou son cœur de rien ou de tout, voire de n’importe quoi… Cette chose inocule le virus de l’écœurement en des âmes de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes.
La bonne nouvelle est que le remède à cette réalité simple est simple lui- aussi… et bien connu ! C’est même un remède « bô kay » pour lequel il n’ait besoin d’importer aucun élément étranger. Au diagnostic* de ce « Gwopwal » atavique, il ne sert à rien d’opposer des commentaires de haut-vol, des actions politiques d’envergure, des thérapies fines ou des allocations substantielles. Il faudra commencer par prier pour que la vérité dissipe les ténèbres et pour nous aimer les uns les autres. Il faudra répondre au spirituel par le spirituel. Et ici nous savons le faire : nou pa bizwen pèson’ ! Par contre, cette prière ne pourra être la prière de quelques mamies, mais une intercession ferme du plus grand nombre, des actes de foi radicaux, des sacrifices spirituels consentis de tous, hommes et femmes, grands et petits. L’amour devra être concret, fraternel, solidaire. Kolé têt’ kolé zépol.
Comptez sur votre Eglise pour vous concocter un chemin de victoire et de joie jusqu’à l’enfant Jésus de la crèche !
+ Fr David Macaire,
Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France ■
En savoir +
* Voir l’incomparable thèse de Claire- Emmanuelle Laguerre (docteure en neuro- science), Événements traumatiques à la Martinique, aux éditions l’Harmattan.
Mais de façon plus idiomatique, le « Gwopwal » désigne un homme ou une femme qui, suit à une déception violente (amoureuse le plus souvent), un choc affectif, un évènement traumatisant, a perdu goût à la vie, se laisse aller aux passions tristes, le dépit, la tristesse, l’amertume ou la colère. Ce n’est pas une personne paresseuse, mais quelqu’un qui ne voit plus par quel moyen surmonter l’épreuve. Le ou les chocs ont été si violents que tout passé se meut en blessure, tout futur devient angoisse, toute relation se colore de méfiance, toute parole perd son sens, tout acte de foi ou d’espérance semble vain, tout mouvement se déroule au ralenti, toute pensée est lasse, tout songe tourne au cauchemar, tout projet semble une impasse, toute amitié pran lavol, … Dépression, débauche et débordements sont les symptômes du « Gwopwal ».
Les anciens moines appelaient ça « le démon de l’acédie ». De fait, c’est ce démon, très reconnaissable, qui conduit au suicide. Il est connu depuis des siècles, mais, en raison de son étrange capacité à susciter des attitudes opposées, il sait se cacher. Il reste invisible aux radars de la politique, de la sociologie ou de la psychologie qui tentent en vain depuis des décennies d’en compenser les effets…
Et pour cause : bien qu’elle ait des racines en tous ces domaines et y porte également ses fruits, l’acédie est une réalité principalement spirituelle. C’est d’abord un esprit mauvais qui exerce vexations et oppressions et fait feu de tout bois pour ronger l’âme humaine.
Chez nous, ce démon, si bien repéré par la sagesse antillaise sous le nom de « Gwopwal », possède une particularité : issu d’une même porte ouverte dans notre histoire inconsciente commune, il s’apparente à un atavisme, il s’enracine dans l’inconscient collectif. Nous avons, tous ensemble, un « Gwopwal », un bon gros « GP ». Ce ne sont pas seulement plusieurs d’entre nous qui sommes mordus par ce serpent au gré de nos existences individuelles, mais tout notre peuple. Une seule et même tristesse provoque çà et là colère, déception, frayeur, esprit de suicide collectif, dégoût, vulgarité, envie de tout casser, de crier, de hurler, de faire mal, de se faire mal, de dire « je vais mal », de partir, de fuir, de laisser tomber ou encore, fringale de consommer, de remplir sa maison, son ventre ou son cœur de rien ou de tout, voire de n’importe quoi… Cette chose inocule le virus de l’écœurement en des âmes de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes.
La bonne nouvelle est que le remède à cette réalité simple est simple lui- aussi… et bien connu ! C’est même un remède « bô kay » pour lequel il n’ait besoin d’importer aucun élément étranger. Au diagnostic* de ce « Gwopwal » atavique, il ne sert à rien d’opposer des commentaires de haut-vol, des actions politiques d’envergure, des thérapies fines ou des allocations substantielles. Il faudra commencer par prier pour que la vérité dissipe les ténèbres et pour nous aimer les uns les autres. Il faudra répondre au spirituel par le spirituel. Et ici nous savons le faire : nou pa bizwen pèson’ ! Par contre, cette prière ne pourra être la prière de quelques mamies, mais une intercession ferme du plus grand nombre, des actes de foi radicaux, des sacrifices spirituels consentis de tous, hommes et femmes, grands et petits. L’amour devra être concret, fraternel, solidaire. Kolé têt’ kolé zépol.
Comptez sur votre Eglise pour vous concocter un chemin de victoire et de joie jusqu’à l’enfant Jésus de la crèche !
+ Fr David Macaire,
Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France ■
En savoir +
* Voir l’incomparable thèse de Claire- Emmanuelle Laguerre (docteure en neuro- science), Événements traumatiques à la Martinique, aux éditions l’Harmattan.
Dans la même catégorie
-
 Diocèse de Martinique
Diocèse de Martinique
Je ne veux plus avoir peur
Sale temps sur la planète ! Et pourtant, après ce que j’ai vu « sur le stade » lors de la Pentecôte Missionnaire 2025, je ne veux plus et ne peux [...]
mardi 1 juillet 2025
Mots de l'évêque -
 Diocèse de Martinique
Diocèse de Martinique
On a toujours fait ainsi
Soixante ans après l’aggiornamento (le toilettage) du concile Vatican II, n’y a-t-il rien de sclérosé dans nos façons de faire ?
mardi 10 juin 2025
Mots de l'évêque -
 Diocèse de Martinique
Diocèse de Martinique
Outai papa ? Outai ?
Ainsi donc, depuis des siècles, pape après pape, l’« Habemus Papam » proclame aux hommes la réponse de l’Église à cette question existentielle si [...]
lundi 26 mai 2025
Mots de l'évêque