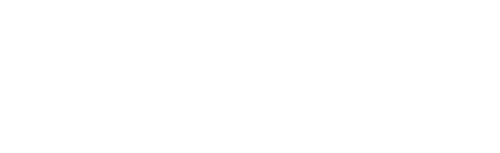Mme Bellassée Valentine (89 ans) partage ses souvenirs d’une époque pas si lointaine où le Carême était observé comme une démarche de conversion, un signe de tristesse, de pénitence et de deuil. Le carnaval se terminant tard dans la nuit du Mardi Gras, il était impensable de se rendre à l'église pour la messe des Cendres le lendemain et de se déguiser ensuite pour poursuivre les festivités, souvent marquées par des excès. C’est pourquoi, pendant des années, l’Église a reporté la célébration du Mercredi des Cendres au vendredi de la même semaine.
Durant cette période, le bruit, la musique et les fêtes étaient proscrits, notamment le mercredi et le vendredi, bien que cette rigueur tende à s’atténuer avec le temps. À partir de minuit, plus personne ne devait se trouver dehors : le Carême commençait !
Même si l'on recevait les Cendres le vendredi, la période de pénitence débutait bien à minuit, le mercredi. La radio n'était allumée que pour les informations et les avis d’obsèques, car toute musique ou bruit festif était proscrit afin de rester en état de recueillement.
Les lieux de bal et autres établissements musicaux fermaient jusqu'à Pâques. Pas de tambour, pas de manifestations culturelles, pas de soirées bèlè. Un autre aspect essentiel du Carême était la privation personnelle afin d'éviter tout péché. Il était interdit d’injurier, de s’adonner à des plaisirs jugés contraires au sacrifice du Christ, y compris l’abstinence sexuelle, même au sein du mariage. L’Église interdisait les injures, les conflits et les représailles, et les parents veillaient à ce que leurs enfants respectent ces principes. Les éclats de rire excessifs étaient réprimés, et la critique d’autrui était très mal perçue : toute parole malveillante exposait son auteur à la réprobation du quartier. Rester dans la prière était de rigueur.
Les parents inculquaient à leurs enfants le sens de la pénitence et de la repentance. Ils en profitaient pour rappeler l’importance du service rendu aux autres. Visiter les malades, tant à l’hôpital que dans le quartier, était une pratique essentielle. On apportait souvent de petits présents : des grenn chou blan, ti-nain, chadèque, caïmite, corossol, patate douce, gombo, abricot pays, canne à sucre épluchée et coupée en baguettes, etc. Celui qui recevait une visite, s'il n’était pas hospitalisé, offrait en retour un présent destiné aux parents du visiteur.
Le jeûne était strictement observé le Mercredi des Cendres et le vendredi. La consommation de viande était proscrite sauf en petite quantité le dimanche et la morue occupait à table une place de choix pendant tout le Carême. Le jeûne impliquait un unique repas à midi, composé de patate douce, d’igname, de salade de carottes, d’herbes amères, d’accras de morue ou de crevettes de rivière, suivi d’une soupe à l’oignon le soir, et ce, durant 40 jours, jusqu'à Pâques. La chasse aux crabes faisait aussi partie des traditions. Les ratières étaient fabriquées par les hommes de la famille pour capturer les crabes destinés au matoutou de Pâques. Une fois capturés, les crabes étaient nourris de feuilles d’arbre à pain et de divers fruits et légumes afin qu’ils se purifient avant leur consommation.
Pendant le Carême, les tenues vestimentaires étaient sobres : pas de couleurs vives. Même les statues de la Vierge dans les maisons étaient voilées de tissu noir ou violet jusqu’au Samedi Gloria. Le "vendredi de la compassion", une dizaine de jours avant le Dimanche des Rameaux, les aînés se rendaient à la communion. Le dimanche suivant était réservé aux femmes mariées. Le Dimanche des Rameaux, tous les enfants allaient à la messe avec leurs palmes bénites qu’ils rapportaient chez eux et dans les chapelles du quartier. Le Jeudi Saint marquait le début d’un silence total dans les foyers. Les enfants ne parlaient que si leurs parents leur adressaient la parole. Le Vendredi Saint, jour de la crucifixion du Christ, les familles participaient aux Chemins de Croix dès 4 h du matin, chantant et priant en procession. Ce jour-là, on s’abstenait de consommer du lait et du vinaigre. Le Samedi Saint, il était de tradition de planter un avocatier ou un cocotier dans la journée. Lorsque les cloches sonnaient le soir, les parents soulevaient leurs enfants au-dessus de leur tête et les secouaient légèrement pour glorifier Dieu et pour les débarrasser de toute influence négative, une coutume aujourd’hui disparue. Le Dimanche de Pâques, les femmes assistaient à la messe de 5h30, tandis que les hommes se rendaient à celle de 8h, où la présence des femmes n’était pas souhaitée par le prêtre.
Ainsi se vivait le Carême en Martinique dans les années 1945 à 1950. Ensuite, petit-à-petit les choses ont changé.
Propos recueillis par Eve-Lyne Bazin ■
Dans la même catégorie
-
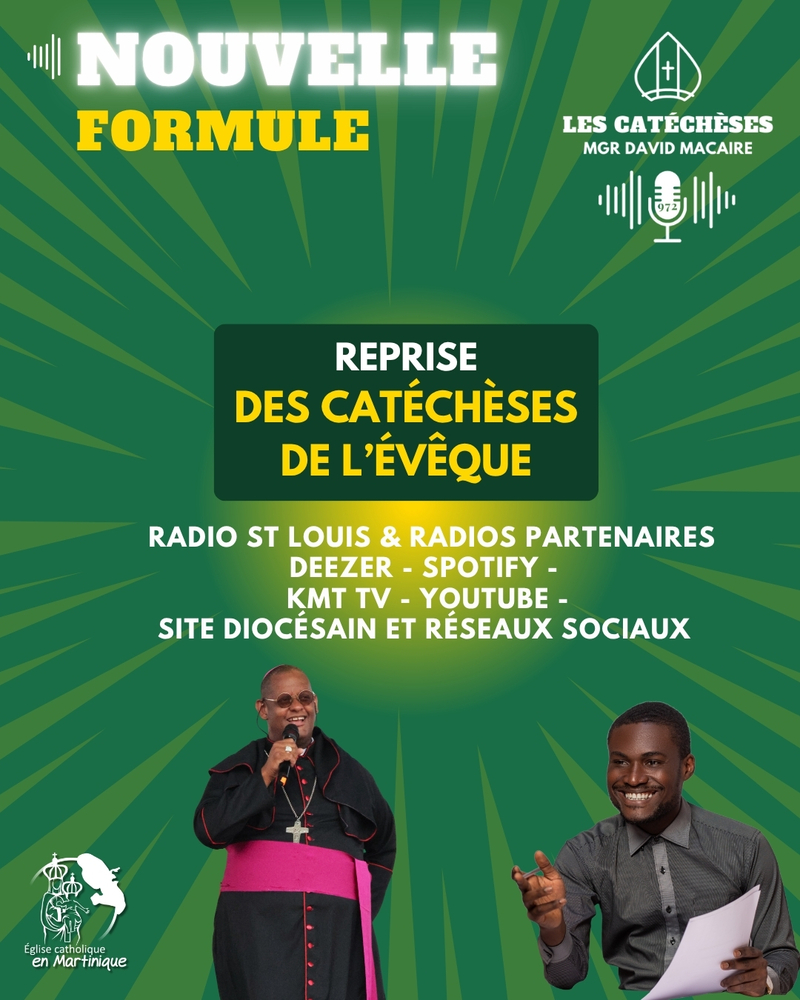 Jeudi20/11
Jeudi20/11Nouvelles catéchèses de Mgr David Macaire : à suivre chaque semaine sur tous nos plateformes partenaires
Les catéchèses de Mgr David Macaire reviennent avec un nouveau format dynamique : un enseignement, puis un débat pour éclairer nos vies sous le thème [...]
Diocèse de Martinique
Pastorale -
 Dimanche16/11
Dimanche16/119ème Journée Mondiale du Pauvre : Justice et solidarité ?
En cette 9ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le Pape François, nous sommes invités à réfléchir sur la solidarité, la dignité humaine, la [...]
Pastorale de la Caritas (CDSC) (Diocèse de Martinique)
Pastorale -
 Lundi03/11
Lundi03/11La communion des saints dans les religions chrétiennes
« Je crois à la communion des saints » affirmons-nous dans le Credo récité par la plupart des confessions chrétiennes : la communion des saints est [...]
Diocèse de Martinique
Pastorale